Parcours patrimonial - Découvrez notre histoire!
-
Découvrez notre histoire!
Panneau Découvrez notre histoire!
Circuit patrimonial : Le patrimoine de Saint-Esprit : Notre héritage, notre avenir
Nous vous invitons à découvrir Saint-Esprit, une municipalité de 2300 habitants au cœur de la MRC de Montcalm dans Lanaudière.
Les premiers colons s’installèrent vers 1784 sur les terres de la seigneurie de L'Assomption, propriété de Satrimonial : Le pieur Roch de St-Ours. Le 7 juillet 1794, 138 habitants apposent leur X près de leurs noms dans une requête destinée à l’Évêque de Québec, afin d’obtenir le droit de construire une maison presbytère pour loger le prêtre qui vient les desservir. C’est en 1808 que la paroisse fut érigée, mais l'érection civile ne fut réalisée qu’en 1835. De 1831 à 1838, la paroisse apparaissait sous trois appellations différentes dans les registres paroissiaux, soient St-Ours du Saint-Esprit, Saint-Esprit ou bien, St-Ours du Grand Saint-Esprit. Ce n’est qu’en 1838 que le nom paroisse Saint-Esprit fut officialisé par l’Évêque de Montréal.
Contrairement aux autres villages de la région organisés de façon principalement rectiligne, le noyau villageois s'est consolidé sous la forme d'un petit bourg d'inspiration française. Ainsi, Saint-Esprit possède plusieurs bâtiments patrimoniaux de grande valeur et cette organisation spatiale en forme de bourg lui procure un attrait unique dans la région. Un article du journal La Patrie de Montréal en 1898 décrit Saint-Esprit ainsi: « Construit de chaque côté de la petite rivière qui porte son nom, le village de Saint-Esprit est aussi remarquable par la beauté de son site, la richesse et l’élégance de ses constructions que la disposition et la propreté de ses rues. Tout, ici, respire l’aisance et la tranquillité des campagnes riches. » Cette richesse de l’époque explique la grande présence de maisons cossues. Lors de votre visite, vous serez à même de constater l’importance de cette richesse patrimoniale.
23 rue Grégoire École du village
Année 1901, Maison de style Georgien
Saint-Esprit possédait plusieurs écoles sur son territoire. En plus du couvent et des trois écoles de rang, l’école du village, réservée uniquement aux garçons, a ouvert ses portes en 1901. Originalement située près du presbytère, cette école fut ensuite déménagée à l’emplacement actuel.
En 1918 l’école devient mixte afin de répondre à la croissance de la population. Cette croissance démographique se poursuit et la petite école du village ne suffit plus. Elle ferme donc ses portes en 1953 lors de l’ouverture de la nouvelle École Dominique-Savio. Malgré les modifications apportées à l’enveloppe du bâtiment aux cours des dernières années, les proportions et plusieurs éléments architecturaux demeurent. Il serait possible de redonner à ce bâtiment son cachet d’origine.


26 rue Grégoire
Année 1906, Maison de style Boomtown
Cette maison Boomtown fut entièrement restaurée au début des années 2010. Les importants travaux ont permis de lui redonner son cachet d’origine. L’installation d’un revêtement de clin de bois horizontal et de portes de bois massif redonnent à cette maison une allure d’époque.

27 rue Grégoire
Année 1857, Maison de style québécoise
Cette maison à toit cintré à la base et de tôle pincée est un bel exemple de la maison typique québécoise. Dans un souci du détail, les nombreux travaux effectués dans les dernières années ont redonné vie à cette magnifique maison. L’installation d’un revêtement de planches à la verticale, de portes et fenêtres de bois à six carreaux, de chambranles ainsi que le choix des couleurs, sont tous en harmonie avec le style et l’époque de la maison.

81 rue Latendresse
Année 1941, Style Art and Craft
Malgré son jeune âge, cette magnifique maison de style Art and Craft est l’une des rares maisons de ce genre à Saint-Esprit. Superbement conservée, cette maison démontre bien que sans être centenaire, une maison peut représenter un intérêt patrimonial incontestable.

84 rue Latendresse
Année 1900, Style éclectisme
Son style est unique dans la municipalité. Sa porte arrondie et son toit de tôle, imitation tuile de terra-cotta, la distingue des autres maisons.

65 rue du Moulin (maison et moulin Dufresne)
Magnifique site en presqu’île où était situé le moulin Dufresne (moulin à moudre) construit en 1858 pour Médard Bouin, dit Dufresne. En 1925, on procède à la construction d’un 2e étage où s’effectuera le sciage et la transformation du bois en matériaux de construction et bois de finition. La force hydro-motrice alimente les deux fonctions du moulin qui fut en fonction jusqu’en 1976, puis démoli en 2014. La majorité du bois et des boiseries des maisons de Saint-Esprit proviennent de ce moulin. Le site fut également l’emplacement du 2e pont (privé) de Saint-Esprit, permettant de rejoindre le rang Rivière-Nord au début du siècle. La première maison du moulin construite vers 1858-1860 était de type québécois. Plus tard, elle fut scindée en deux maisons distinctes. Ces dernières sont toujours existantes et sont situées sur la rue Euclide.
15 - 19 rue des Écoles
Année 1929, Style Art and Craft
Typique des maisons d’après-guerre, cette maison s’inspire du courant Art and Craft. Ce type incarne le retour à la simplicité, au travail de l’artisan avant l’industrialisation et l’urbanisation. L’apparence demeure assez sobre et simple. Tout est dans le jeu des volumes des toits à faibles pentes munis d’une lucarne en chien-couché. La galerie, agrémentée de colonnes doriques et de consoles, le toit en tôle pincée et les nombreuses ouvertures ajoutent de la prestance à cette maison.


37 rue Principale
Année 1880, style second empire à mansarde
Récemment rénovée, cette maison retrouve son charme d’antan. À remarquer; le souci du détail apporté à la nouvelle toiture en tôle et à l’habillage des cheminées.

38 rue Principale
Année 1844, style québécois
Demeure du Docteur Elzéar Brouillette en 1880, elle fut également l’emplacement de la caisse populaire durant quelques années. Cette maison typiquement québécoise en pièce sur pièce possède un toit cintré en tôle pincée, ainsi qu’une lucarne en chien-assis. Les colonnes et les consoles sont d’origine. Cette maison possède également un revêtement extérieur singulier de bardeau d’amiante-ciment, unique en son genre dans la région. Ce composite d’amiante et de ciment Portland est apparu au début du 20e siècle.

50 rue Principale (auberge/Hôtel Victoria)
Année 1938
Dès 1880, c’est l’auberge Perreault qui avait pignon sur rue à cet endroit. En 1938, un incendie rasa le bâtiment, mais l’Hôtel Victoria y fut immédiatement reconstruite. On y proposait des chambres, un restaurant et un bar/taverne. L’imposant bâtiment actuel fût un lieu de restauration. Les colonnes de galerie sont d’origine. Avec l’ancien magasin général Beaudoin et frères, qui était situé juste en face, l’hôtel Victoria était au cœur de la vie des résidents de Saint-Esprit.



52-54 rue Principale
Année 1926, Style Victorien
Cette demeure très bien conservée possède beaucoup d’éléments architecturaux typiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À l’intérieur, les murs, plafonds, les moulures faites de plâtre et les boiseries nombreuses donnent une prestance certaine à cette résidence. Notez que la fondation de pierre de taille piquée, la galerie de bois richement décorée, son toit de tôle pincée, ainsi que les vitraux présents dans les impostes des fenêtres et des portes démontrent bien l’aisance financière des propriétaires de l’époque. Cette maison est la deuxième construite à cet endroit, la première ayant été détruite par un incendie. Cette demeure a la particularité d’avoir une sœur jumelle à quelques adresses de distance, soit au 44 rue Principale.

55-57 rue Principale
Année 1921, Style Victorien
Construite par le notaire Joseph Ferdinand Daniel, cette Victorienne de brique rouge fut la résidence du docteur Émile Martinbeau au cours des années 40. Le détail de l’ornementation de la galerie de bois est typique de plusieurs maisons de Saint-Esprit. On retrouve ces mêmes éléments sur la structure de plusieurs résidences, dont sa voisine au 52-54 rue Principale. Il est fort raisonnable de penser que le même artisan réalisa les travaux de finition et d’ébénisterie sur ces maisons. La majorité des fenêtres sont d’origine, de même que le toit de tôle pincée et la fondation de moellon. À noter que cette maison partage un mur mitoyen avec la maison de gauche, ce qui est assez rare dans les villages en région.

60 rue Principale
Année 1913, Style Boomtown
Cette maison de style Boomtown fut construite par le notaire Joseph-Ferdinand Daniel afin d’y installer son étude de notaire et une filiale de la Banque Canadienne Nationale. Le notaire Daniel occupa plusieurs postes importants dans le milieu municipal et fut l’un des propriétaires de la Compagnie de tabac de Montcalm et directeur de la compagnie d’électricité Québec Southern Power Corporation. En 1940, un autre notaire prit la relève. Le notaire Jean Durand s’impliqua à la municipalité et à la commission scolaire de Saint-Esprit jusqu’en 1969. Il fut également député du comté de Montcalm et conseiller législatif. À noter les luminaires extérieurs d’origine, les larges linteaux de pierre, la fondation de pierre de taille, la rampe de fer forgé à l’étage et la présence d’une saillie sur la gauche du bâtiment qui était occupée à l’origine par une voute. À l’époque, un fronton richement décoré était également présent sur le toit.

64 rue Principale
Année inconnue, Style second empire à mansarde
Imposante demeure ayant été l’emplacement du bureau du docteur Joseph Lamarche vers 1904. Elle fut également le site de la banque provinciale et du bureau des Véhicules automobiles dans les années 50. Quoique ayant subi des modifications au fil des années, la volumétrie est restée la même et demeure un bel exemple cossu de ce style de bâtiment. En effet, le 2e étage est complet et non intégré dans la mansarde, ce qui donne beaucoup de hauteur et permettrait même l’aménagement d’un 3e étage.


88-90 rue Principale
Année 1916, Style Victorienne
Cette grande demeure de brique a su conserver au fil des années plusieurs éléments architecturaux originaux. À remarquer; les doubles fenêtres de bois à deux sections, les consoles de galerie, ainsi que le toit en tôle pincée d’origine.

26 rue Montcalm
Année inconnue, style second empire à mansarde
Toiture à mansarde à quatre versants cintrés en tôle à baguette. La toiture de la galerie est faite de tôle pincée.

29 rue Montcalm
Année 1900, style second empire à mansarde
Cette maison de brique, également à mansarde quatre versants droits, conserve encore aujourd’hui plusieurs éléments architecturaux d’origine. À remarquer; les consoles de galerie, les chambranles richement décorés des fenêtres de l’étage et les boiseries sous la corniche.

36 rue Montcalm
Année 1930, style vernaculaire américain
Abandonnée pendant plusieurs années, cette maison était dans un état avancé de détérioration lorsqu’elle fut rénovée dans les années 1990-2000. Les rénovations effectuées ont permis de conserver le style de la maison. À cet effet, la galerie et les colonnes doriques d’origine ont été sauvegardées.

42 rue Montcalm
Année inconnue, style québécois
Maison québécoise à toiture à l’anglaise. Les fenêtres, colonnes et chambranles sont d’origine.

50 rue Montcalm
Année 1905, style vernaculaire américain
Anciennement la résidence du curé Barette lorsqu’il prit sa retraite en 1937, cette maison fut entièrement rénovée au début des années 2010. Les propriétaires ont su garder et conserver le cachet de cette maison. En effet, les matériaux et les couleurs reflètent le style d’origine, et le toit de tôle pincée également.

58 rue Montcalm
Année 1871, style Géorgien
Cette maison est l’une des rares maisons de style Géorgien à Saint-Esprit, les autres ayant disparues à la suite d’incendies. En 1887, le docteur Pierre-Julien-Léonidas Bissonnette en devint propriétaire. Ce dernier fut nommé Gouverneur du collège des médecins de la province du Québec en 1897 et député de Montcalm pour le parti libéral ensuite. Le cordonnier St-Yves, qui travailla à Saint-Esprit durant près de 40 ans, en sera également propriétaire.

59 rue Montcalm
Année 1908, style vernaculaire américain d’inspiration néo-Queen Ann
Cette maison possède sa toiture en tôle à la canadienne et son revêtement de bois d’origine. Le choix des couleurs et leurs proportions permettent de mettre en évidence les nombreux détails architecturaux de boiseries qui la recouvrent.

60 rue Montcalm
Année 1885, style victorien
Possédant un atelier de menuiserie très lucratif sur le terrain adjacent, Onésime Brouillette construisit cette luxueuse maison Victorienne. À remarquer; les nombreux détails de boiserie sur les chambranles, les corniches, les consoles, les pignons et la grille faîtière. Les fenêtres à battant sont d’origine.

66 rue Montcalm
Année 1905, style Boomtown d’influence victorienne
Avec son toit plat et sa tourelle, cette maison de brique de style Boomtown possède certains éléments d’inspiration victorienne. Les consoles, colonnes et plusieurs corbeaux de corniche sont toujours présents.

67 rue Montcalm
Année 1901, style victorien
Cette maison fut construite par Raphael Charbonneau, un riche commerçant. Il était propriétaire d’un magasin général et de l’aqueduc, du début du siècle jusqu’aux années 1960. Son fils, le dentiste Bruno Charbonneau demeura également dans cette maison. On remarque les traces d’une ancienne galerie couverte qui faisait toute la façade et le côté gauche de la maison.

68 rue Montcalm
Construction 1900, style victorienne d’inspiration Queen-Ann
Cette imposante demeure Victorienne fut construite par Avila Lachapelle entre 1896 et 1900. Boulanger de profession, M. Lachapelle fut celui qui construisit et opéra la boulangerie de Saint-Esprit (four à pain en pierre) durant de longues années au 117 Montcalm, ce qui explique la présence des vestiges d’un tel four dans le sous-sol de cette maison. Avec ses grandes pièces et ses plafonds de plus de 10 pieds, l’intérieur a conservé ses caractéristiques d’origines telles que les murs de plâtres, les vasistas et les nombreuses moulures et portes ouvragées qui ornent les pièces de la maison. À l’extérieur, le choix des couleurs permet de mettre en valeur la mouluration détaillée des boiseries, corbeaux et caissons de la corniche. On remarque aussi les nombreux détails architecturaux des chambranles de fenêtre. Les éléments de l’immense galerie tels que les colonnes doriques sont d’origine. Fait intéressant : cette maison était la seule à posséder une toiture complète d’ardoise avec motifs, ce qui démontre bien l’aisance financière de son propriétaire à l’époque.

72 rue Montcalm
Année 1904, style Boomtown
Cette maison de brique a subi peu de changements au fil des années. Ses consoles, ses colonnes tournées, ses fenêtres de bois doubles (guillotine et battant), de même que ses corniches arquées sont d’origine.

85-93 rue Montcalm
Année 1925, style Boomtown d’inspiration victorienne
Avec son toit plat, sa tourelle et les détails architecturaux, cette maison combine deux styles, soit le Boomtown et le style victorien. Son immense parapet de brique avec motifs et ses impostes de fenêtres en vitraux lui donnent beaucoup de prestance. La galerie est richement décorée de boiseries. À noter que les détails architecturaux de la galerie sont les mêmes que plusieurs maisons de la rue Principale.

99 rue Montcalm
Année 1912, style victorien
Cette maison de brique fut construite par Achile Lamarche, prospère commerçant de bois et de grains. Le dentiste Bruno Charbonneau y installa son bureau pendant de nombreuses années (1934-1975) et le dentiste Michel Brisson prit la relève de 1978 à 2013. Cette maison a conservé ses éléments architecturaux d’origine. La galerie possède plusieurs boiseries décoratives et le détail des fenêtres de bois est très intéressant. La toiture de la tourelle, en tôle écailles de poisson, est spectaculaire. À noter l’imposte de tête de lion dans la brique.

103-105 rue Montcalm
Année 1912, style victorien
Grande maison victorienne de brique ayant abrité un comptoir de la caisse populaire. Cette maison appartient à la famille Rivest depuis ses débuts. Située sur un immense terrain, elle possède à l’arrière plusieurs bâtiments de ferme d’époque.

117 rue Montcalm
Année 1892, style second empire à mansarde
Cette maison fut l’emplacement de la boulangerie du village. Avila Lachapelle, boulanger, fit construire en 1897 un four à pain chauffé au bois, permettant de faire cuire le pain à l’ancienne. La boulangerie fut ouverte jusqu’en 1990, soit près de cent ans après sa construction. La galerie possède de l’ornementation et des motifs typiques que l’on retrouve sur plusieurs maisons de Saint-Esprit. L’immense four à pain est toujours présent dans la maison.

121 rue Montcalm
Année 1905, style Boomtown
Cette maison Boomtown possède quelques éléments associés au style second empire, dont le toit de la galerie du 2e étage fait en tôle écailles de poisson. Le revêtement extérieur est fait de tôle embossée, imitant la pierre de taille. La toiture est d’origine et faite en tôle à baguette. L’ornementation de la galerie et les poteaux tournés sont d’origine. Cette maison fut celle de Lionel Rochon, menuisier, qui possédait son atelier de bois à l’arrière. Ce dernier est toujours présent et est recouvert de son bardeau de cèdre d'origine. De nombreux éléments architecturaux des maisons de Saint-Esprit proviennent de l'atelier de Lionel. Monsieur Rochon fut également policier municipal de Saint-Esprit et mandataire du bureau des licences.


Saint-Esprit possède des centaines de maisons patrimoniales sur son territoire. Que ce soit lorsque vous parcourrez le circuit patrimonial de ce document ou lors d’une promenade dans le village ou dans les secteurs agricoles, nous vous invitons à porter attention à la richesse patrimoniale de Saint-Esprit. Vous y découvrirez des petits trésors!
Contenu et texte © Pascal Rochon
-
Histoire de Saint-Esprit en 12 capsules
CAPSULE # 1
Le développement de la côte du Saint-Esprit et origine de la seigneurie de Lachenaie, du fief Martel et du fief de Bailleul (1647-1775)
La seigneurie de Lachenaie et les fiefs Martel et de Bailleul
L’histoire de la municipalité de Saint-Esprit remonte au milieu du XVIIIe siècle. Connue à cette époque sous le nom de la côte du Saint-Esprit, plusieurs éléments sont à prendre en considération afin de permettre une meilleure compréhension de cette période fondatrice. Tout d’abord, le territoire actuel de Saint-Esprit se situe dans ce qui était en 1750 la seigneurie de Lachenaie, le fief Martel et le fief de Bailleul. L’histoire de la seigneurie nommée Lachenaie débute le 11 mai 1670 [1], alors que Charles Aubert de La Chesnaye reçoit en donation de Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny la quasi-totalité de la seigneurie de Repentigny. Cette dernière avait jadis été concédée à Pierre Legardeur de Repentigny en 1647 [2]. Quant à la partie ayant demeuré aux Legardeur de Repentigny, il faut savoir que seule celle au sud de la rivière l’Assomption (où est l’actuelle ville de Repentigny) fut alors conservée. Au début du XVIIIe siècle, une nouvelle transformation de cet immense territoire eut lieu suite à l’achat en 1701 de la seigneurie de Lachenaie par Raymond Martel et Augustin Le Gardeur de Courtemanche [3]. Suite à sa mort accidentelle survenue en novembre 1708, Martel aura laissé à son fils Nicolas, en juillet 1707, une part de sa seigneurie (Lachenaie) en fief [4], il s’agirait ici du fief Martel. Quant au fief de Bailleul, celui-ci fut créé à même la seigneurie de Lachenaie pour son autre fils, Pierre Martel, en mars 1708 [5]. En 1715, Pierre Le Gardeur de Repentigny acquière la seigneurie de Lachenaie et les fiefs Martel et de Bailleul [6]. 35 ans plus tard, il, avec son épouse Agathe de Saint-Père, « …abandonnèrent… [7] » en séparant entre leurs enfants la seigneurie de Lachenaie, suivi plus tard des fiefs Martel et de Bailleul [8]. Un résultat important de ce partage est l’acquisition d’une imposante part de cette seigneurie par Pierre-Roch de Saint-Ours d’Eschaillons en 1765 [9]. Suite à cela, l’appellation seigneurie de Lachenaie sera accolée encore quelques années aux gens de la côte du Saint-Esprit, plusieurs contrats de bornage de terres dans la décennie 1770 en témoignent. Finalement, en plus d’une partie de la seigneurie de Lachenaie, Paul-Roch de Saint-Ours d’Eschaillons acquière les fiefs Martel et de Bailleul en 1765 [10]. Afin de permettre une meilleure compréhension de la division du territoire de la côte du Saint-Esprit, il faut savoir qu’une partie relève de la seigneurie de Lachenaie, une autre du fief Martel, et une autre du fief de Bailleul. Le lecteur peut situer ces trois territoires seigneuriaux grâce à ces repères actuels ; le village de Saint-Esprit est dans la seigneurie de Lachenaie, le ruisseau Saint-Esprit dans le fief Martel, et le Moulin bleu de la paroisse Saint-Roch-de-l’Achigan dans le fief de Bailleul.
La colonisation primitive de la seigneurie de Lachenaie et des fiefs Martel et de Bailleul (1647-1750)
La période couvrant les années 1647 et 1700 ne fut point favorable à un établissement massif de colons dans la seigneurie de Repentigny, tantôt Lachenaie, les guerres franco-iroquoises fréquentes sont un élément justifiant ce découragement. Jusqu’en 1701, peu de concessions sont ouvertes dans les terres de l’immense seigneurie, la population préférant sans doute la proximité avec les autres paroisses près du fleuve (dont Lachenaie (1683) et Repentigny (1669)). La grande paix de Montréal de 1701 apporte la possibilité aux colons d’ouvrir des concessions aux abords de la rivière l’Achigan, pour ne nommer que celle-ci, déclenchant alors le développement tant espéré de la seigneurie de Lachenaie en sa partie septentrionale. Par exemple, des colons forment, autour des années 1750, une communauté aux alentours de l’actuelle paroisse de l’Épiphanie, alors connue sous le nom de l’Achigan [11]. Le nord, situé au-delà du grand coteau de l’Épiphanie, est encore peu connu, quoique certaines concessions existent près de la rivière l’Achigan en amont du lieudit de l’Achigan. Des entreprises d’exploration sont donc lancées dans le fond de la seigneurie afin d’établir de futurs colons [12]. C’est ainsi qu’entrent en scène deux nouveaux territoires, La Chute de l’Achigan (Saint-Roch-de-l’Achigan) et la côte du Saint-Esprit (Saint-Esprit).
Causes du développement de Saint-Esprit (1740-1775)
Au cours des années 1740-50, des expéditions sont effectuées aux bords de la rivière Saint-Esprit afin d’y établir des colons. Des premières concessions sont attribuées principalement comme monnaie d’échange ou bien « … utilisées comme terres à bois… [13] ». La richesse des terres est l’élément qui motiva les premiers défricheurs à s’installer, ceux-ci arrivent surtout après la cession de la Nouvelle-France aux Britanniques en 1763. Ce sont alors principalement des jeunes hommes qui s’établissent en vue d’y faire vivre une famille [14]. Malgré un sol fertile, la fin des années 1760 montre que peu de personnes résident en permanence à la côte du Saint-Esprit. De plus, la colonisation en cet endroit n’aurait pu se faire aussi aisément sans celle qui se faisait en même temps à La Chute (Saint-Roch-de-l’Achigan). Cette colonisation simultanée eut pour principale conséquence de favoriser l’établissement de réseaux de parenté. Il faut savoir que les colons du fond de la seigneurie de Lachenaie ne forment pas encore des communautés indépendantes, les terres de la côte du Saint-Esprit et de La Chute sont dans les années 1740-1787 un démembrement de la paroisse de Saint-Pierre du Portage (l’Assomption) [15]. En effet, ces deux territoires d’arrière seigneurie n’en forment qu’un seul. Ce lien demeura bien des années entre Saint-Pierre du Portage et Saint-Esprit, mais la cohésion entre La Chute et la côte du Saint-Esprit ne demeura pas aussi longtemps. Bien vite, ces deux emplacements voulurent se séparer l’un de l’autre afin de former des paroisses distinctes. Mais avant cela, il fallut bien que ces gens s’établissent au Saint-Esprit.
Prochainement, il sera question de leurs premiers habitats. De plus, l’heure est à l’ouverture des concessions, et non à former une communauté distincte. Par contre, cela ne tardera pas. Il sera question de tout cela dans la chronique à venir.
CAPSULE # 2
Le développement de la côte du Saint-Esprit (1750-1775)
Les premières cabanes (1750-1775)
Les premiers colons résidant à la côte du Saint-Esprit habitent dans des habitats sommaires et temporaires. En effet, ils construisent eux-mêmes leur petite cabane, en attendant l’éventuel habitat permanent mieux bâti. Contrairement à la pensée populaire, ces petites habitations ne sont pas toujours faites en bois rond, mais pouvaient être également en bois équarri ou bien refendu. Quant à leur aspect, il faut savoir que deux manières de construire se démarquent, la première est en pièce sur pièce à l’horizontale et la seconde est de pieux en terre à la verticale. Les toitures de ces cabanes sont en appentis ou bien à deux versants peu pentus. L’intérieur se résume à une seule pièce à même le sol, garnie de peu de meubles (dont un coffre), un foyer de pierre permettait de réchauffer la pièce [16]. Ce dernier pouvait être central, ou bien sur un des murs pignons. La pérennité de ces premiers témoins architecturaux sur le territoire de Saint-Esprit n’était pas faite pour durer; l’absence de fondation, la précarité de la construction ou bien le recyclage postérieur en bâtiment agricole auront eu raison de leur destruction à moyen terme. Ces cabanes sont érigées dans une clairière ouverte par le colon lors de son arrivée sur la terre. Elles sont le plus souvent construites près des cours d’eau, cela pour favoriser le transport humain et l’approvisionnement en eau. À une époque où les chemins carrossables sont presque inexistants, il faut trouver un moyen rapide de locomotion. Le canot est donc prisé, il permet aux habitants du Saint-Esprit de se visiter « … sur de courtes distances… [17] ». Tout de même, les chemins suivant la rivière ne tardèrent pas à s’ouvrir, les colons ayant alors la responsabilité de les faire [18]. L’heure est donc à l’ouverture des concessions, et non de former une communauté distincte. Par contre, cela ne tardera pas. Il en sera question dans une prochaine chronique
CAPSULE # 3
Le développement de Saint-Esprit et les revendications de ses habitants pour en faire une paroisse (1775-1800).
L’éloignement géographique avec les autres paroisses; les conséquences
À l’aube des années 1780, les gens de la côte du Saint-Esprit sont de plus en plus désireux de fonder leur paroisse. En effet, ils sont à cette époque contraints de se déplacer sur de grandes distances lorsque vient le temps des offices religieux. À cette période, les gens les plus près de la nouvelle paroisse de Saint-Jacques-de-la-Nouvelle-Acadie se rendent à son presbytère-chapelle, d’autres vont à l’église de L’Assomption [19]. De plus, les marchands à cette époque sont surtout à L’Assomption, plusieurs des colons de la côte du Saint-Esprit y effectuent alors leurs achats [20]. Cet éloignement géographique important créera alors le besoin de fonder une paroisse, cela afin d’avoir une église et des marchands à proximité.
Une paroisse à faire; la côte du Saint-Esprit vs La Chute (Saint-Roch-de-l’Achigan) (1775-1787)
Le seigneur Paul-Roch de Saint-Ours a un dessein bien précis en ce début des années 1780, soit celui de faire sa paroisse autour de son domaine seigneurial à La Chute. Par contre, son projet suscita des réactions négatives chez les gens du Saint-Esprit, ces derniers veulent plutôt s’établir près du ruisseau de la Fourche (aujourd’hui ruisseau Saint-Esprit). Cela remonte aux années 1770 alors que le seigneur Roch de Saint-Ours leur demanda de contribuer à la construction de sa future église dans son domaine, endroit où est son moulin banal à farine [21] datant de 1771. L’éloignement est donc l’élément clé justifiant le refus et le mécontentement ressentis par les gens du Saint-Esprit, ils ne consentiront pas à « …fournir [des matériaux] attendu la trop [grande] distance… [22] ». En 1787, Paul-Roch de Saint-Ours fonde la paroisse de de Saint-Roch (Saint-Roch-de-l’Achigan) près de son domaine [23]. Cela représente alors une demie victoire pour les gens du Saint-Esprit, ils auront désormais une église plus près, mais le facteur de l’éloignement demeure tout de même présent. La venue des années 1790 sera décisive quant au sort du territoire du Saint-Esprit, de par l’arrivée de nouveaux colons, en partie causée par les « …réseaux de parenté… [24] ». Ce poids démographique jouera en la faveur des habitants devant le seigneur Paul-Roch de Saint-Ours et l’évêque de Québec.
Portrait d’une communauté en devenir (1790-1797)
Depuis 1787, la côte du Saint-Esprit est une concession de la nouvelle paroisse de Saint-Roch, elle sera désormais connue sous le titre de concession du Grand Saint-Esprit. Tel que mentionné précédemment, les réseaux de parenté ont amené de nouvelles familles au Saint-Esprit. Parmi eux, nommons les Colin, Laperche dit Saint-Jean, Martineau, Perreault, Rivet et Vézina [25]. Elles s’ajoutent aux nombreuses autres retrouvées sur le territoire depuis près de 20 ans. La saturation démographique des vieilles paroisses de Québec représente un des éléments justifiant la colonisation en la concession du Grand Saint-Esprit [26]. Cet essor démographique, ainsi que le territoire trop vaste de la paroisse de Saint-Roch, demandèrent alors la venue d’un capitaine de milice en la concession [27]. C’est alors qu’entre en scène le capitaine Étienne Turgeon, figure importante quant à la fondation de la future paroisse à venir. Il contribua à la requête de 1794 adressée à l’évêque de Québec, laquelle demande la « …création d’une paroisse en bonne et due forme […] et la construction d’un presbytère [28] ».
En route vers la fondation de la paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1797-1800)
En 1797, un moulin à scie existe dans la partie de la seigneurie de l’Assomption (anciennement seigneurie de Lachenaie) [29]. Ce moulin est le second connu de la paroisse de Saint-Roch, un autre ayant été également construit dans un méandre de la rivière Saint-Esprit en 1781 [30]. Un plan de la paroisse en devenir est également tracé en 1797 par un arpenteur l’ayant fait pour Monsieur de Saint-Ours [31]. Le plan démontre que Paul-Roch de Saint-Ours est alors intéressé à faire du Grand Saint-Esprit une paroisse distincte [32]. Les principaux chemins imaginés y sont dessinés (ils ressemblent beaucoup à ceux retrouvés actuellement) et commencent même à être ouverts physiquement durant les deux dernières années du XVIIIe siècle. La contribution de certains colons ne peut-être passée sous silence, plusieurs d’entre eux ayant vendu des chemins afin de créer un réseau routier adéquat pour la future paroisse [33]. Ces ouvrages routiers ont été grandement menés par le capitaine Turgeon [34], cela en vue d’offrir de meilleurs déplacements dans la concession. Avant la venue de ces nouvelles routes, la rivière et certains petits chemins de fortune furent alors les seules voies de transport offertes.
Isolée dans les années 1770-1780, la côte du Saint-Esprit, ensuite concession du Grand Saint-Esprit, se développa dans les années 1790, favorisée par certains éléments importants. En effet, forte d’un capitaine de milice actif et influent, de moulins à proximité et d’un réseau routier amélioré, ce n’est alors qu’une question de temps avant la naissance officielle la future paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit. Les évènements vont donc s’enchaîner rapidement, permettant la construction d’une église en pierre et la fondation officielle tant attendue de la paroisse avant la fin des années 1810.
CAPSULE # 4
La première église de Saint-Esprit (1803-1901) : Regard sur son influence quant à la naissance de la paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1800-1808)
Brève histoire entourant la construction de la première église (1780-1800)
Les premières années du XIXe siècle furent charnières au Grand Saint-Esprit. En effet, une église en pierre est construite en peu de temps, suivie de près par la fondation de la paroisse. Ce tourbillon d’événements a des racines au XVIIIe siècle. En effet, la question de l’église à bâtir vers 1780 devient de plus en plus sérieuse au début des années 1790. En 1794, les colons, appuyés par le capitaine Étienne Turgeon et Monsieur de Saint-Ours, envoient une requête à l’évêque de Québec, Mgr. Hubert. Ils lui demandent de permettre la construction d’une église et d’avoir un prêtre résidant [35]. Faute de certains éléments qui ont été en défaveur des colons du Grand Saint-Esprit, leur requête fut rejetée. Une seconde tentative est menée en 1797, encore sans succès [36]. Quatre ans plus tard, soit en 1801, l’accord est enfin donné par Mgr. Denault [37]. L’église peut être construite.
La construction de la première église (1800-1806)
La répartition des matériaux nécessaires et l’estimation des coûts de la construction commencèrent apparemment en septembre 1800 [38], ce malgré que le projet ne soit pas encore accepté par Mgr. Denault. Ces délibérations entre les nouveaux syndics et les habitants concernent la participation de ces derniers à la construction de leur future église. Le 16 octobre 1802, un contrat est passé devant le notaire Joseph-Édouard Faribault, soit celui du « Marchez de la Maconne de l’Eglise et Sachristy de la Nouvelle paroisse de St. Esprit [39] ». Ce marché fourni les dimensions de l’église à construire, soit environ 117 pieds de longueur, 45 pieds de largeur et près de 29 pieds de hauteur [40], le tout en mesures actuelles. Ce marché concerne le gros œuvre de maçonnerie. Les bâtisseurs doivent commencer les travaux le 15 juin 1803, et les compléter pour juillet 1804 [41].
C’est donc le 15 juin 1803 que doit, selon le marché d’octobre 1802, débuter la construction de l’église sur le terrain de l’église actuelle. La pierre nécessaire se trouve déjà, en grande partie, sur place depuis 1800 environ. Cette première partie des travaux, qui fait partie du gros œuvre, consiste à faire une excavation pour ensuite maçonner les larges fondations de l’église. D’une largeur variant de 4 pieds 3 pouces (pour presque tous les murs) à 5 pieds 3 pouces (pour le mur-pignon en façade) [42] , elles sont surmontées par les murs visibles dans l’église, lesquels murs en extérieur sont un peu plus minces à leur sommet [43]. Il est à propos d’évoquer la question des ouvertures (fenêtres et portes) qui doivent être pratiquées dans les murs. À la cave (endroit où seront déposées plus tard des sépultures), quelques soupiraux sont faits. Les murs de l’église, eux, ont dix grandes fenêtres [44]. Sur une photographie de l’église prise à la fin du XIXe, il y a en façade trois portes, dont la plus haute et large est au centre. Il se retrouve également une grande fenêtre haute au-dessus de la porte centrale, et icelle fenêtre est surmontée d’un oculus (œil de bœuf). Les emplacements de ces ouvertures seraient inchangés depuis le début des années 1800. À l’arrière, une sacristie doit être construite selon le marché de 1802, elle fait près de 25 pieds 6 pouces de largeur sur 29 pieds de longueur [45], mesures actuelles.
Les ouvrages succédant ceux de la maçonnerie concernent la charpente de l’église et de la sacristie, en plus des travaux sur les couvertures en bardeaux à faire. Ces ouvrages sont détaillés dans un marché de construction encore une fois passé devant le même notaire Faribault, le 2 février 1804 [46]. En résumé, le maître-charpentier engagé, Pierre Dufour dit Latour, doit faire la charpente des toitures et celle du clocher. De plus, il se doit de couvrir de bardeaux l’église et de recouvrir correctement le clocher en tôle, bardeaux et fer-blanc. Le temps alloué pour réaliser ces ouvrages importants s’échelonne du 1er mai 1804 au mois de septembre 1804. Fort heureusement, le Sieur Dufour dit Latour a déjà à sa disposition tous les bois de construction (bois équarris, planches, billots pour faire les bardeaux) [47]. Il ne lui faudra apporter que les clous, ferrures et autres nécessités pour compléter les ouvrages de charpenterie et de couverture [48]. En ce qui a trait à la menuiserie, les ouvrages extérieurs et intérieurs ont possiblement débuté simultanément ou peu après ceux de charpenterie, et ils se sont prolongés presque sans interruption pendant près de 20 ans.
La fondation de la nouvelle paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (3 janvier 1808)
En 1806, le seigneur Paul-Roch de Saint-Ours écrit que « … [les habitants du St. Esprit] […] ont réussi à faire une très belle église… [49] ». Elle est en forme de croix latine. Cette construction, bien qu’ayant engendré certains différents [50] entre les syndics et les habitants, aura sans doute tenu un rôle de premier plan quant à l’ouverture du livre de fabrique, le 12 décembre 1807 [51]. Cette ouverture eut lieu quelques jours après la consécration de l’église par le curé J. J. Raizenne [52]. C’est le 3 janvier 1808 que la paroisse de Saint-Ours-du- Grand-Saint-Esprit est fondée concrètement [53]. Tout de même, il n’y a toujours pas de curé résidant, ni de presbytère. Dans la prochaine capsule, le sujet gravitera autour des conditions de vie des habitants (soit de 1808 à 1820), et en quoi sont-elles différentes de celles des années 1770-1800.
CAPSULE # 5
Effets du développement territorial, matériel, socio-économique et social sur les habitants de la nouvelle paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1808-1820)
Rappel sur le développement territorial de la concession du Grand Saint-Esprit (1790-1808)
Au début des années 1790, les défrichements progressent dans la concession du Grand Saint-Esprit. Pour démontrer cela, il serait à propos de dresser le portrait fictif d’un colon, établi au Saint-Esprit depuis 1780. Dans ce scénario inventé, il est prospère et son entreprise de défrichement évolue d’une manière relativement rapide. Sa concession totale fait 60 arpents. Ce sont environ de deux à trois arpents par année qui sont mis en terre labourable [54], ce qui pourrait porter ce nombre à environ 22 arpents en 1791. Toujours en cette année 1791, le reste de sa terre est en bois debout, une réserve vitale pour bâtir son habitation, faire son bois de chauffage, etc. Au début de la période étudiée dans la présente capsule, soit 1808, ce fictif colon a complété le défrichement de sa terre, laissant toutefois une partie en bois debout. Enfin, le territoire de la concession du Grand Saint-Esprit connu le développement d’un réseau routier à la fin du XVIIIe siècle.
Bref portrait de la vie matérielle, socioéconomique et sociale dans la nouvelle paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1808-1820)
Le scénario fictif vu dans le précédent paragraphe montre bien que le colon possède désormais une terre à cultiver fertile, il se dirige alors vers la prospérité. Pour lui et bon nombre d’autres colons, les conditions de vie sur une terre vers 1808-1820 s’améliorent. Comme premier exemple de cela, de nombreuses maisons permanentes sont construites aux abords de la rivière Saint-Esprit durant cette période [55]. Elles suivent les nouveaux chemins récemment ouverts. Les familles voient donc sans doute leurs conditions de vie s’améliorer grâce à ces habitations, sûrement construites avec davantage de soin que les cabanes de colonisation temporaires.
Paul-Louis Martin, historien et ethnologue [56] québécois, écrivit que « …la grande maison rurale (de 77 mètres carrés et plus) surgit dans le paysage avec la maturité d'un terroir… [57] »
Il subsiste actuellement quelques demeures en pierre datant de cette période. Il est à propos de voir les caractéristiques principales de ces maisons. À l’extérieur, la volumétrie générale est plus imposante que les petites cabanes de colonisation. Le toit peut y être assez pentu, le carré principal quant à lui est plutôt bas. Il y a davantage d’ouvertures que sur les maisons temporaires (elles peuvent aussi être plus grandes), ce qui éclaire davantage l’espace intérieur. Ce dernier est assez spacieux, il pourrait être sans doute « …unicellulaire[…] ou à deux pièces, munie[…] ou non de quelques cabinets… [58] », un plan intérieur typique des maisons canadiennes au XVIIIe siècle [59]. Un mur de refente, pouvant être longitudinal ou transversal, sépare les pièces, il est généralement au centre ou presque du logis. Une ou deux cheminées de pierre (peu ou fortement massives) chauffent l’intérieur. Le grenier est inhabité, il ne sert qu’à entreposer des grains ou bien des victuailles en hiver [60]. Pour payer ces maisons, certains habitants économisent au fil des ans l’argent recueilli de la vente des surplus de récoltes. Cela leur permet de « …faire appel plus fréquemment qu'auparavant à des artisans professionnels… [61] » pour construire leur maison. Certes, il est fort à parier que plusieurs habitants ont construit leur maison permanente eux-mêmes.
Comme second exemple, la place de la famille a contribué au développement territorial de la nouvelle paroisse. Comment? La réponse gravite autour des cellules familiales (parents et enfants), et de leur contribution aux travaux agricoles et de défrichement [62]. Le mariage est donc un élément fort pour le développement socioéconomique de la jeune paroisse. En effet, l’épouse apporte bestiaux, meubles, vaisselle [63], « …sa pleine et entière participation aux travaux de la terre… [64] », etc. Pour sa part, l’époux, lui, fournit entre autres un logis et une terre [65]. Au niveau économique, outre les surplus des récoltes vendus, des « …habitants-défricheurs… [66] » vont tirer profit de la vente du bois, bois se trouvant dans leur terre à bois. Ils vendent ces bois à des commerçants de l’Assomption, et ces derniers les « …revend[ent] ensuite aux Britanniques [67] ». Cela est une conséquence des guerres napoléoniennes (1799-1815) [68]. En effet, freinée par les blocus continentaux qui lui sont obligés dès 1806 par Napoléon, l’Angleterre ne peut plus aller quérir du bois en Europe [69]. La métropole britannique se tourne alors vers ses possessions de l’Amérique du Nord britannique pour s’approvisionner [70].
Comme dernier exemple, le développement social dans la décennie 1810 peut se faire remarquer entre autres par la volonté des colons d’affirmer une certaine cohésion communautaire. En 1811, plusieurs habitants font savoir à l’évêque de Québec, Jean Oliver, leur mécontentement à l’égard des syndics de l’église de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit [71]. Ils clament que les coûts importants pour payer l’église achevée sont élevés [72]. Près de 47 chefs de famille ont signé [73]. D’autres éléments qui renforcent le caractère communautaire se trouvent dans la foi et la ferveur catholique, elles ne manquent point à Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit. Vers 1810, les habitants attendent toujours leur prêtre résidant et un presbytère. En 1818, l’autorisation pour en bâtir un est enfin donnée [74], et l’année 1819 voit son premier curé résidant de la paroisse arriver, le curé Périnault [75]. Comme le veut l’usage, le presbytère dans les paroisses canadiennes catholiques de l’époque comporte certes le logement du curé, mais aussi une grande salle pour les habitants. Cet endroit fut un véritable lieu social, culturel et politique [76].
Vers 1820, Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit est un lieu qui se développe. De plus, des maisons mieux faites poussent un peu partout, dans lesquelles vivent des familles de plus en plus nombreuses, dont certaines connaissent une amélioration économique. De plus, un esprit communautaire est bien présent, en grande partie grâce à l’existence de l’église et du presbytère [77]. Dans la prochaine capsule, les années 1820-1841 seront à l’étude.
CAPSULE # 6
Les années 1820 à 1841 : Une période de changements
Une paroisse qui se démarque
Au début des années 1820, Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit est désormais un endroit qui témoigne son indépendance face aux paroisses avoisinantes. En effet, la venue du premier curé en 1819, soit le curé Périnault, facilite l’accès aux services religieux [78]. De plus, la construction d’un premier moulin à farine sur le territoire de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit, vers 1819 [79], ne contraint plus la mouture des grains dans les paroisses limitrophes [80]. Au plan artistique, il y a la décoration intérieure de l’église, laquelle a débuté en 1820 par Joseph Pépin de Saint-Vincent-de-Paul [81] [82].
Une paroisse et son désir d’instruction publique
Depuis 1801, des tentatives sont entreprises au Bas-Canada pour instruire la jeunesse. Par contre, ce n’est qu’en 1829 que le premier système scolaire efficient est créé, soit les écoles de Syndics [83]. Il s’implante rapidement à Saint -Esprit. Un acteur de premier plan dans ce dossier sur l’instruction est le nouveau curé Charles-François Caron, arrivé dans la paroisse en 1827 [84]. Il est le président de l’assemblé des syndics scolaires, même si le rôle du clergé dans la gestion des écoles élémentaires est laissé aux laïcs depuis 1829 [85]. Une maison d’école au village (située près de l’église) ouvre à cette époque. Hélas, le nouveau curé Bellenger note en 1836 que la jeunesse peine à s’instruire [86], le « …rejet, en mai 1836, de la loi sur les écoles élémentaires [de 1829] [87] » n’aide pas. Pour clore le sujet de l’instruction dans la période étudiée, la maison d’école au village est désormais entretenue à même les fonds de la Fabrique dès 1841 [88].
Portrait de la paroisse de Saint-Esprit au début des années 1830
S’il est un sujet peu connu aujourd’hui, c’est bien celui la genèse du village de Saint-Esprit. Tout de même, la présence en 1831 de gens de métier, commerçants ou journaliers près de l’église laisse sous-entendre la présence d’un petit noyau villageois. Le recensement de 1831 montre qu’il y a 1889 habitants [89] dans la paroisse de Saint-Esprit, laquelle fut érigée canoniquement en 1830 [90]. Quant aux maisons, il y en a 319 habitées, 10 inhabitées et 7 en construction [91]. Les terres occupées par les cultivateurs se chiffrent à environ 13 500 arpents [92], et « …un peu plus de 9600 [arpents] sont déclarés comme cultivés [93] ». Au niveau de l’instruction, deux écoles élémentaires sont présentes sur le territoire [94]. Trois auberges sont à la disposition des habitants sur le territoire de Saint-Esprit [95]. En ce qui a trait aux principales industries, il y a deux moulins mus par l’eau, soit un à scier et un à moudre (vers 1819) [96].
Saint-Esprit et les Rébellions des Patriotes de 1837-1838
Depuis 1827, le parti Patriote gagne la sympathie de plusieurs Canadiens au Bas-Canada [97]. Lorsque éclatent les rébellions en novembre 1837, les paroisses de Saint -Esprit, de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Lin sont alors des lieux sympathiques à la cause des Patriotes [98]. Le notaire Louis Jannot à Saint-Esprit est considéré comme un « …agitateur… [99] » par le curé Bellenger [100]. Fort de tout cela, un nombre élevé de paroissiens est favorable aux idées des rebelles. Par contre, trois éléments vont progressivement instaurer un climat de neutralité face aux événements. En octobre 1837, un mandement rédigé par Monseigneur Lartigue est envoyé dans toutes les paroisses du Bas-Canada, celui-ci met en garde la population des dangers de la fièvre patriotique [101]. En décembre 1837, des nouvelles négatives concernant les défaites des Patriotes démoralisent plusieurs sympathisants à Saint-Esprit [102]. Durant la même période, le gouverneur du Bas-Canada fait passer dans la population une requête de soumission à la reine Victoria, cela afin de maîtriser le flot révolutionnaire [103]. En somme, la ferveur rebelle a donc diminué, mais certains habitants de Saint-Esprit demeurent récalcitrants. En exemple, un habitant de Saint-Esprit se leva de son banc d’église lors d’un office religieux en s’exclamant « …non, je ne la signerai pas [la requête de soumission à la reine Victoria] … [104] ».
Vers les années 1840: Entre traditions et modernité
Depuis 1835, la paroisse est officiellement reconnue civilement [105]. Elle se nomme alors paroisse de Saint-Esprit, et ce depuis 1829 [106]. En 1838, l’appellation Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit est délaissée au profit de Saint-Esprit [107]. À l’aube des années 1840, le Bas-Canada est mal en point, l’économie ne s’est pas vraiment améliorée et la situation politique ne prend pas le tournant espéré par les Patriotes. Tout de même, la vie à Saint-Esprit n’a pas été si modifiée par les événements de 1837-38. L’importance de la religion est encore aussi présente. En exemple, la chute du clocher dans l’église, survenue le 24 juillet 1841, mobilise plusieurs habitants pour sa reconstruction [108]. Dans la prochaine capsule, il sera question de la moitié du siècle à Saint-Esprit (1841 à 1860).
CAPSULE # 7
La paroisse de Saint-Esprit au milieu du XIXe siècle : un bref aperçu (1841-1861)
Les années 1841-1861 ont été dans le Bas-Canada une période de grands changements. Les Insurrections de 1837-1838 et leur suite (le Rapport Durham entre autres) ont semé dans le Bas-Canada une incertitude quant à l’avenir des Canadiens français, tant au niveau économique que politique. En ce qui a trait à la vie des habitants de Saint-Esprit suite à cet évènement historique, celle-ci ne fut pas changée de façon drastique au cours des années 1841-1861. Ils continuent de vivre à l’intérieur d’une solide communauté, et dans laquelle la religion catholique et l’héritage francophone (la langue, la culture) dominent. Tout de même, il ne faut pas croire que le changement et le progrès se sont arrêtés aux limites de la paroisse. En exemple, la gestion administrative dans les campagnes francophones s’apparente de plus en plus à celle anglaise. Pour les territoires régis par les seigneurs, un chapitre va bientôt se tourner, la gestion seigneuriale des territoires provenant du régime français arrive bientôt à sa fin. Le milieu des années 1850 a vu l’abolition du régime seigneurial, plus précisément en 1854 [109]. Les années 1841-1861 à Saint-Esprit voient son territoire changer et sa population éprouvée par divers malaises. La présente capsule abordera ces sujets.
Mise en place d’une instance municipale à Saint-Esprit
Suite aux Rébellions de 1837-1838, l’Acte d’Union de 1841 créé la province du Canada (le Haut-Canada devient le Canada-Ouest et le Bas-Canada devient le Canada-Est) [110]. Plusieurs francophones voient alors dans cet acte une volonté dissimulée d’assimilation des Canadiens français dans la mer anglophone qui les entourent [111]. À Saint-Esprit, cela n’a pas tant d’incidence, il n’y a presque pas d’anglophones durant la période. La vie suit relativement le même cours que dans la précédente décennie, sauf peut-être pour certaines personnes ébranlées par les répercussions des Rébellions [112]. Par contre, un évènement majeur arrive dès 1841, soit la mise en place « … du premier régime municipal… [113] » dans la paroisse de Saint-Esprit. Cette nouveauté, alors déjà bien installée dans les États-Unis et l’Angleterre, ne fit pas le bonheur de certains habitants [114]. Certains sont encore trop « … ébranlé[s] par les tumultes politiques [115] » de 1837-38, ce nouveau système venant « … des autorités britanniques… [116] » est alors mal vu [117].
Crise économique, crise sanitaire et exode rural (émigration)
La situation économique de plusieurs habitants de Saint-Esprit n’est guère reluisante au début des années 1840. La pauvreté règne en maître dans plusieurs foyers de la paroisse, et de nombreuses familles de cultivateurs peinent à vendre leurs récoltes [118]. Afin de subvenir à leurs besoins essentiels, plusieurs d’entre elles s’en remettent à la vente des produits de l’érable, alors fortement populaire dans « … les marchés des villes… [119] ». Toutefois, cela n’est pas assez, et la situation économique prendra encore plusieurs années avant de se stabiliser. À la fin des années 1840, soit en 1849, un bref épisode de choléra prendra la vie de 11 personnes dans la paroisse [120]. Celui-ci a été causé par le passage d’immigrants irlandais en direction du canton de Rawdon [121]. En plus de la crise économique et sanitaire, un phénomène d’exode secoue les campagnes vers 1849, l’émigration dans les grandes villes [122]. Les États-Unis sont un lieu pour travailler qui en tentent plus d’un, les manufactures urbaines sont à la recherche de main d’œuvre [123]. Les conditions de plusieurs habitants de Saint-Esprit étant alors peu enviables, certains quittent pour améliorer leur sort [124]. Les difficultés de la vie ont parfois même entrainé chez certaines personnes un excès dans la consommation de liqueurs fortes [125]. Cela sera critiqué par le curé Charron dans les années 1840-50, car il y a alors plusieurs cas d’ivrognerie à Saint-Esprit. Ce dernier prend cela sérieusement, il va « … [favoriser] l’établissement de la tempérance dans la paroisse [126]». Au début des années 1860, l’ivrognerie est alors moins importante que dans les années 1840 [127].
Brève histoire entourant l’annexion de la côte Saint-Louis à la paroisse de Saint-Esprit
Lors des délibérations entourant l’érection canonique de la paroisse, soit vers 1829, plusieurs habitants de la Côte Saint-Louis désirent s’annexer entièrement à la paroisse de Saint-Esprit [128]. Ceux-ci font alors partis de la paroisse de Saint-Roch, et se jugent trop éloignés d’icelle [129]. C’est en grande partie pour cette raison qu’une annexion à la paroisse de Saint-Esprit est un choix judicieux [130]. Leur demande ne sera pas réalisée, et ce ne sera qu’en juin 1860 que le territoire de la Côte Saint-Louis fut officiellement transféré à Saint-Esprit [131]. Par contre, étant donné que le territoire de Saint-Esprit est devenu plus grand, il fut convenu de céder le lieu de la Petite Rivière à la paroisse de Sainte-Julienne [132].
Le début des années 1860
Au terme de la période, il est possible de noter certains faits dans la paroisse. Le recensement de 1861 vient démontrer qu’il y a environ dans la paroisse 221 maisons en bois et 30 en pierre [133]. Il faut aussi ajouter que vers 1858, un nouveau moulin à moudre fut construit près de l’église [134].
CAPSULE # 8
LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT : EN ROUTE VERS LA PROSPÉRITÉ? (1861-1881)
Les activités économiques et professionnelles dans la paroisse de Saint-Esprit
Durant la période étudiée, l’économie est bien importante et diversifiée. Une grande partie de la population vit de l’agriculture [135], alors que l’autre est plutôt composée d’artisans ou de notables. À cette époque, plusieurs secteurs d’activités fournissent divers services. Il est donc à propos de commencer par celui de l’agriculture. Alors que l’autosubsistance et l’autarcie tendent à disparaitre, la modernisation des techniques de culture et une plus grande commercialisation des produits agricoles prennent de plus en plus de place [136]. Les principaux clients des cultivateurs sont alors les grands marchés des villes, car les demandes alimentaires en zones urbaines sont importantes [137]. Quelle est donc la situation de l’agriculture au début de la période 1861-1881? Il faut savoir qu’une sécheresse a nui aux récoltes chez les habitants de Saint-Esprit en 1860, et dans plusieurs jardins d’habitants « …les vers et toutes espèces de vermines mang[ent] et détruis[ent] tout [138] ». Ces deux faits consignés dans le recensement de 1861 laissent voir un tableau peu reluisant de la situation agricole à Saint-Esprit. Par contre, le recenseur a également écrit que cela ne représente pas la situation ordinaire au Bas-Canada (Canada-Est). Dans les années 1870, la modernisation de l’agriculture a introduit le concept de spécialisation [139]. En exemple, plusieurs cultivateurs de Saint-Esprit vont accroître ou bien entamer la production commerciale de tabac à pipe vers 1875 [140]. En ce qui concerne les machines nouvelles qui facilitent l’agriculture, il est inscrit dans le recensement de 1871 que 23.5 machines à battre et 1 moissonneuse-batteuse sont employées à Saint-Esprit.
Les industries les plus importantes entre 1861 et 1881 sont des moulins activés par la force hydraulique. En 1861, Nicolas Bouin dit Dufresne ainsi que Charles Rivais opèrent chacun un moulin à moudre, et André Roy Audy opère un moulin à scie. Seul celui de M. Bouin dit Dufresne peut être localisé exactement, il fut jadis au cœur du village [141]. Dix ans plus tard, le recensement de 1871 démontre que deux servent à moudre et deux à scier. De ces quatre-là, le moins actif (un pour scier opéré par Cézaire Bélanger) n’a fonctionné qu’un mois et demi dans l’année 1871, contre douze mois pour celui de Médard Payette (celui-là sert à moudre).
Plusieurs marchands font des affaires dans la paroisse de Saint-Esprit entre 1861 et 1881. Il y a présence de quelques magasins en 1871, dont celui d’Aimé Riopelle, de Charles Dalpé, de Jean-Baptiste Archambault, d’Adélaïde Rivest et de Narcisse Tellier. Il est possible de trouver chez monsieur Riopelle « a (sic) peu près de tout : denrées alimentaires (farine, sucre, etc… (sic)), tissus, articles divers, ainsi que de la quincaillerie [142] ». Outre les magasins, il y a en 1871 une auberge dans le village, soit celle de Médard Payette (ce dernier opère également en 1871 le moulin à moudre au cœur du village) [143]. Cette auberge, devenue propriété de Jean-Baptiste Lebeau dit Marien aux alentours de 1877-78 [144], ferme ses « … portes […] au début de l’année 1880 [145]».
Il a dans la période un nombre important d’artisans dans la paroisse [146]. Il se trouve alors des boutiques de forgeron, de menuisier, de charpenterie, de voiturier, de cordonnerie, de tannerie et de ferblanterie. De plus, il ne faut oublier les quelques boulangeries sur le territoire. Il existe alors une diversité intéressante, témoin d’une prospérité qui s’installe peu à peu. Outre les artisans, les notables sont dans la paroisse de Saint-Esprit bien présents durant la période 1861-1881, ce qui lui confère une qualification de « ‘’paroisse aux professionnels’’ [147] ». Trois notaires professent simultanément en 1871, dont le plus âgé est Louis Jannot (il a professé de 1830 à 1874 [148]). Outre ces notaires, près de quatre médecins ont assuré la bonne santé des paroissiens [149].
Quelques éléments de la vie sociale et religieuse à Saint-Esprit
Le précédent paragraphe a fait l’éloge de l’activité économique et professionnelle à Saint-Esprit, mais il «… ne faut pas penser que tout le monde profit[e] de la prospérité… [150] » de la même manière. Plusieurs personnes durant l’époque 1861-1881 ne voient qu’une solution pour sortir de leur malaise économique, l’émigration, surtout dans certaines villes aux États-Unis où les manufactures offrent plusieurs emplois [151].
En ce qui a trait à la religion catholique, les gens de Saint-Esprit sont sensibles à leur foi chrétienne. L’exemple du premier couvent peut en témoigner. En 1873, Messire Michel Charron, prêtre, «… devient l’acquéreur d’une maison entourée d’un vaste terrain [152] » [153]. Messire Charron souhaite laisser le tout aux Sœurs de Sainte-Anne, car il juge que la paroisse a besoin de ce type d’institution pour les jeunes filles [154]. C’est donc en 1876, suite à une volonté dans son testament rédigé en 1875, que les Sœurs s’installent dans la maison [155]. Il s’agit d’une habitation en pierre «… à laquelle on a ajouté une annexe en bois, le tout […] recouvert d’un crépi-gris bleu… [156]». Le lendemain, quelques gens de la paroisse s’informent déjà auprès des Sœurs pour inscrire leur(s) fille(s) [157]. En plus de leur chapelle aménagée dans le comble de ladite maison [158], un jubé leur sera même destiné dans l’église en 1876 [159].
CAPSULE # 9
LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT À L’AUBE DU XXe SIÈCLE : UNE AGRICULTURE AMÉLIORÉE ET UNE ARCHITECTURE DIVERSIFIÉE (1881-1899)
En 1890, l’annuaire Lovell dit de Saint-Esprit que son village est prospère [160]. En effet, sa petite bourgade villageoise bourdonnait d’activités, les nombreuses maisons cossues situées dans le village en ont été des témoins, tant hier qu’aujourd’hui. Une cause de cela réside dans le fait que plusieurs personnes dans la paroisse ont trouvé plusieurs éléments positifs à la modernité. Toujours selon le Lovell, 1500 personnes habitent dans la paroisse [161], et dans le recensement de 1891, cette dernière comporte 285 maisons, dont 236 sont en bois, 27 en brique et 22 en pierre [162]. Dans cette capsule, deux thèmes ont été retenus. Le premier porte sur l’agriculture ainsi que son impact sur l’enrichissement de la paroisse, et le second est une conséquence de ce phénomène, soit l’enrichissement de l’architecture villageoise.
La situation de l’agriculture s’améliore
Alors que la situation agricole durant la période 1861 et 1881 est stable et les rendements suffisants, quelques éléments entre 1881 et 1899 ont modifié considérablement l’agriculture à Saint-Esprit, en voici quelques exemples. Depuis le 1er février 1851, la société d’agriculture du comté de Montcalm diffuse des connaissances et techniques modernes chez les cultivateurs [163]. Malgré tous ces efforts en éducation agricole, plusieurs habitants du comté ne sont pas vraiment à jour en cette matière vers 1880 [164]. Certes, plusieurs cultivateurs profitent et améliorent leur condition grâce aux nouveaux savoirs agricoles (ex. leurs cultures se diversifient [165]), mais il y en a d’autres qui continuent à cultiver selon de vieilles manières non-rentables. Un exemple de ces manières inefficaces sont « … les labours se [faisant] sans précaution et à la hâte […] [et qui] sont souvent mauvais [166] ». Finalement, les années 1890 voient se développer l’industrie laitière [167], laquelle prendra progressivement de plus en plus de place à Saint-Esprit (surtout au XXe siècle). Bref, les familles de cultivateurs ont, et ce depuis les débuts de la paroisse, contribuées à la prospérité, tant pour elles-mêmes que pour l’établissement d’une cellule villageoise importante. Le fait qu’elles aient besoin de services (magasins, docteur, notaire, services religieux, etc.) font qu’elles paient pour ceux-ci. De ce fait, les personnes offrant ces services s’enrichissent en plus de faire profiter toute la paroisse.
L’architecture villageoise à Saint-Esprit
Il n’y a pas que le secteur de l’agriculture qui connut un élan de modernité important. Il serait à propos de dresser un portrait de la riche diversité architecturale alors présente à Saint-Esprit entre 1881 et 1899. Il ne sera question ici que de l’architecture au village et de trois styles architecturaux.
En 1898, le journal La Patrie expose son avis quant à la situation du village de Saint-Esprit :
… la richesse et l’aisance de ses constructions […] [et] la disposition et la propreté de ses rues […] [font] que tout, ici, respire l’aisance et la tranquillité des campagnes riches.. (sic) [168]
Vers 1899, des bâtiments aux allures du style géorgien se retrouvent dans la partie sud du village. En 1898, la maison du Dr. Pierre-Julien Léonidas Bissonnette [169] (construite en 1871 [170]) et le magasin de Wilfrid Beaudoin [171] évoquent les particularités de ce style. Ces bâtiments à la mode anglaise possèdent un toit moyennement pentu; des corniches fastueuses ornées de corbeaux; une symétrie rigoureuse; deux étages; des grandes fenêtres, etc. Il faut savoir que le style géorgien en cette seconde moitié du XIXe siècle est quelque peu démodé et dilué dans le style victorien à la mode. Il n’est donc guère surprenant que le tambour d’entrée ornementé devant la maison du Dr. Bissonnette et les ornements sur la façade du magasin de Wilfrid Beaudoin soient des éléments victoriens. Le lecteur doit savoir que le mélange de ces styles se nomme éclectisme architectural. Quant aux bâtiments traditionnels québécois galbés, ils sont bien présents en 1881-1899. Le bureau de poste [172] et le magasin du marchand Aimé Riopelle [173] en témoignent. Par contre, le style qui mérite le plus d’attention entre 1881 et 1899 est sans contredit celui des bâtiments victoriens à toit mansardés, son essor à Saint-Esprit est fort important dans les années 1880. Deux exemples éloquents de ces bâtiments entre 1881 et 1901 sont l’auberge de Camille Vézina [174] et la maison du menuisier Onésime Brouillette [175]. L’architecture victorienne est donc bien présente à Saint-Esprit. Elle est visuellement et technologiquement associée à certains éléments, en voici quelques-uns. Depuis les années 1860 environ, deux matériaux de construction connaissent une démocratisation sans précédent dans l’architecture rurale lanaudoise. Le recouvrement des couvertures avec de la tôle à baguette est alors populaire durant la période 1881-1899. La brique est aussi un recouvrement mural extérieur fort prisé. En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie pendant la période, ceux-ci sont facilités par la modernisation des boutiques de menuisier (des machines activées par la force humaine sont en usage [176]). Cela fait en sorte que l’opulence des ornements victoriens sur ces maisons contribue à démontrer la richesse de son propriétaire. L’architecture à Saint-Esprit est donc entre 1881 et 1899 fort diversifiée et témoigne d’une activité économique bien rodée.
CAPSULE # 10
LES DEUX PREMIÈRES ÉGLISES DE LA PAROISSE DE SAINT-ESRIT : UN BREF APERÇU DE LEUR ARCHITECTURE (1ère : 1803[177] - c. 1902 et 2e : 1902-1931)
En ce début du XXe siècle, Saint-Esprit est un lieu important du comté de Montcalm. Ce qui démarque le plus cette paroisse est, comme il fut mentionné à maintes reprises dans les capsules précédentes, sa prospérité économique, sociale, professionnelle, marchande, agricole, religieuse, etc. Dans le présent texte, il sera question de l’architecture religieuse en extérieur des deux premières églises à Saint-Esprit. Deux époques seront retenues pour les présenter, la première concernera le début du XIXe siècle (1ère église) alors que l’autre s’intéressera au début du XXe siècle (2e église).
À la fin du XVIIIe siècle et début XIXe, la société canadienne française est encore bien attachée à la tradition architecturale de leur ancienne mère-patrie, soit la France. La personne ayant fait les plans de l’église de Saint-Esprit vers 1802 semble s’être s’inspiré des manières de construire développées au Régime français (1608-1760) [178]. En extérieur, les murs épais en pierre, les ouvertures en plein cintre, le fruit des murs, le plan en croix latine et la sobriété des ornements extérieurs sont des exemples éloquents. Elle a l’air à première vue d’une petite église de la première moitié du XVIIIe siècle, s’apparentant à l’ancienne de Lachenaie (1730-1888). Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses! Malgré cet aspect plus ancien, la modernité s’est invitée lors du traçage des plans vers 1802. Les portes latérales en façade, le clocher à deux lanternes et les dimensions plus spacieuses sont quelques exemples de l’évolution qui touche alors l’architecture religieuse traditionnelle québécoise [179]. 100 ans plus tard, l’église de Saint-Esprit perdra ce caractère nouveau, elle est jugée trop exiguë et en mauvaise condition [180].
La première église de Saint-Esprit est détruite vers 1902. Plusieurs de ses pierres semblent avoir été insérées dans la maçonnerie du solage de sa remplaçante. La seconde église commence à être construite en 1902 et est un mélange éclectique des styles néo-roman et néo-gothique [181]. Alors que la situation économique précaire des gens du « Grand Saint-Esprit » en 1802 ne permettait pas d’importantes dépenses, la situation est fort différente en 1902. La paroisse veut alors un temple neuf qui les représente à la fois au plan économique et démographique. Les éléments de décor en extérieur peuvent montrer cette richesse, en voici quelques exemples; pinacles, lucarnes en œil de bœuf, niches, croix faitières, colonnes engagées, corniches et moulures élaborées, etc. Ses caractéristiques esthétiques lui ont permis d’être qualifiée comme une des plus belles églises du diocèse de Joliette [182]. Elle sera malheureusement anéantie le soir du samedi 9 mai 1931 par un incendie [183]. Le feu aurait soit pris naissance derrière le grand autel [184] ou dans la chaufferie de la cave [185]. Un bris mécanique de la pompe à incendie de Saint-Esprit a retardé l’opération d’arrosage des flammes, lesquelles ont alors pu évoluer rapidement vers l’avant de l’église [186]. Afin d’alerter la paroisse, certains hommes s’activent à sonner « …le tocsin… [187] », mettant en danger leur propre sécurité [188]. « Puis, les cloches se turent… [189] » peu de temps après car « … […] le feu s’[est] répandu dans la charpente du clocher [190] ». Ce dernier s’écroula « …quelques secondes plus tard… [191] ». Le lendemain matin, il ne reste que des ruines, soit des amas de pierre éparpillés par-ci et là, des tôles froissées ou encore des restes calcinés difficilement identifiables.
C’est ainsi que se conclut l’histoire brève de ces deux anciennes églises. Bien que la seconde ait été réduite à l’état de souvenirs à cause de l’incendie du samedi 9 mai 1931, elle a tout de même laissé à la postérité les dimensions de l’église actuelle. La troisième église fut reconstruite sur ses fondations, lesquelles gardent la trace de plus de 200 ans d’histoire d’architecture religieuse spiritoise.
CAPSULE # 11
LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 20e SIÈCLE : PETIT SURVOL HISTORIQUE DE QUELQUES ÉLÉMENTS (1900-1950)
Le secteur de l’agriculture en constante évolution
Au début du XXe siècle, les progrès en agriculture entamés dès le dernier quart du XIXe siècle ne s’essoufflent pas, bien au contraire. La spécialisation de certains cultivateurs dans le tabac dès 1875 [192] a contribué à instaurer La compagnie de tabac du comté de Montcalm, ouverte vers 1900 sur la rue principale [193]. L’industrie laitière continue elle aussi d’évoluer entre 1900 et 1950, « …la forte demande des produits laitiers incit[e] les cultivateurs à grossir leur troupeau [194] ». La beurrerie de la rue Saint-Louis, opérante depuis environ 1910 [195], témoigne de cet essor. La venue « …[d’]un nouveau type de commerce : la livraison du lait [196] », le fait également. De plus, l’apparition d’équipements modernes entre 1890 et 1910, comme l’écrémeuse, facilite la tâche des cultivateurs [197]. Cependant, tous ne peuvent se procurer ces biens dispendieux, ce qui peut amener les cultivateurs à tirer de moins bons profits sur la vente de leur lait [198]. La production céréalière est elle aussi en essor, mais la disparition d’une des industries les plus anciennes de la paroisse, soit les moulins à moudre, va gêner les cultivateurs au courant des années 1940 [199]. En effet, il n’y en a plus dans cette décennie, une meunerie coopérative est donc fondée en 1947 pour les remplacer [200] (aujourd’hui le C.A.G). Une autre production, soit la production porcine, se développe également [201]. Finalement, la vente des produits de l’érable [202] est aussi populaire qu’elle l’était au XIXe siècle [203]. Elle représente « …une source de revenus intéressante et complémentaire pour plusieurs cultivateurs [204] ». Bref, l’agriculture à Saint-Esprit est bien diversifiée.
La vie économique : Les artisans, commerçants et professionnels dans la paroisse
Les cinquante premières années du XXe siècle ont vu une pluralité de corps de métier dans la paroisse. Dans les artisans du secteur de la construction, il y a des charpentiers, des menuisiers, des ferblantiers et des « faiseurs » de chaux. D’autres artisans fabriquent des objets de la vie courante, comme les charrons, forgerons, tailleurs, ferblantiers, cordonniers, etc. Il y en a aussi dans le secteur alimentaire, comme les boulangers, bouchers, fabricants de biscuits [205], etc. Plusieurs commerces spécialisés sont aussi implantés en plus des magasins généraux. Il y a entre autres un entrepôt de poêles, un magasin de bonbons, un magasin de meuble, des salons de barbier, des restaurants, des épiceries, des postes à essence, des salons de coiffure, des magasins de vêtements et fourrures, des garages [206], etc. Comme au XIXe siècle, il y a toujours une panoplie de professionnels, notaires, docteurs [207]. Il y a aussi des dentistes, un nouveau type de profession qui apparaît à Saint-Esprit vers les années 1930 [208]. Pour conclure cette section sur la vie économique, il est bon de mentionner quelques industries importantes dans la paroisse. Le moulin Dufresne au cœur du village est un bon exemple. Il appartient encore en 1900 à cette famille, mais cela change en 1912 lorsqu’il est vendu à M. Avila Vézina [209]. Toutefois, c’est son fils Clodomir qui modernisera considérablement le vieux moulin de 1858 [210] vers 1925, l’année où il l’a acquis [211]. Ces transformations concernent entre autres l’ajout d’un étage, ce qui permet au moulin d’être à triple fonction, soit pour moudre, scier et travailler le bois (menuiserie) [212].
L’instruction des jeunes enfants
Au XXe siècle, la construction d’écoles au village sera importante. Il sera ici question de l’école du village construite vers 1900 [213]. D’origine mixte et dirigée par des institutrices, elle sera prise en charge par les Sœurs de Sainte-Anne en 1918 [214]. En 1940, l’instruction des jeunes garçons (cette école est alors réservée pour eux) est désormais entreprise par les Frères de Saint-Gabriel [215].
La troisième église de 1932-1933
L’église actuelle, qui est la troisième, succéda celle de 1902 incendiée le soir du 9 mai 1931 [216]. Le nouveau temple, conçu initialement par Zotique Trudel (décédé « …entre-temps… [217] ») et ensuite par Ludger Lemieux, fut construit par la Compagnie Paquet et Godbout de Saint-Hyacinthe. L’église est faite de ciment, et ce tant pour les murs que pour la toiture. La nouvelle église est en 1933 bien différente de l’ancienne, elle est plus « …austère… [218] » et « …ne fut décorée que dix-sept ans plus tard [219] ».
La paroisse de Saint-Esprit branchée : L’électrification dans la paroisse
Il faudra attendre les années 1910 avant de voir arriver le courant électrique dans le village de Saint-Esprit. Il est entre autres installé vers 1918 dans l’église [220]. Dès lors, les villageois bénéficieront progressivement de ce service. Malgré cela, plusieurs familles de cultivateur des rangs ont dû attendre encore quelques années avant d’être rattachées au réseau. Cependant, il y a certaines exceptions, une partie du rang Rivière Sud a déjà l’électricité avant 1945 [221]. L’Office de l’électrification rurale achèvera donc ce travail dès 1945, de sorte que 11 ans après la fin de la période à l’étude, soit « …en 1961, 97% des fermes québécoises disposent de l’électricité [222] ».
CAPSULE # 12
L’HISTOIRE DE SAINT-ESPRIT DE 1950 À AUJOURD’HUI : UNE RENCONTRE ENTRE LE PASSÉ ET LE PRÉSENT.
La période des années 1950 à aujourd’hui fut une fois de plus marquée par des transformations au niveau religieux, économique, de l’instruction des jeunes, de l’agriculture, etc. Il ne sera question dans cette dernière capsule que de ces quatre thèmes fréquemment évoqués dans les autres capsules. Il faut que le lecteur sache que cela ne représente qu’une infime partie de l’histoire consignée et orale [223] de cette époque.
Courte histoire de la religion catholique à Saint-Esprit depuis 1950 : Déclin ou adaptation?
La pratique de la religion et l’aspect des bâtiments religieux ont connu des changements depuis les années 1950. L’église fut décorée en 1950 par Maître Guido Nincheri [224], natif de Toscane en Italie [225]. Ce dernier a été « formé à la grande Académie des beaux-arts de la ville de Florence… [226] ». Lors du 150e anniversaire de Saint-Esprit en 1958, la place du religieux dans la vie communautaire est encore bien présente. Au final, malgré tous les changements qui ont ensuivi la Révolution tranquille québécoise, ou bien ceux du renouveau liturgique de 1965 [227], la religion catholique occupe toujours une place importante chez plusieurs Spiritois. Elle s’est adaptée à « …un monde en évolution […] avec des valeurs différentes [228] ».
Une vie économique bien ancrée à Saint-Esprit
La diversité des types de commerces et services offerts à Saint-Esprit continue de faire d’elle un pôle commercial depuis les années 1950. Par exemple, outre les magasins et commerces vus dans les précédentes capsules, il y a en 1958 des électriciens, des camionneurs, des garages, des boutiques de soudure, des vendeurs pour des compagnies, un réparateur de radios et télévisions [229], etc. Cependant, plusieurs de ces lieux commerciaux ou de services, surtout des magasins, ont fermé, et certains bâtiments ont même été convertis en logements résidentiels. La paroisse de Saint-Esprit n’est pas pour autant totalement dépourvue de ces lieux commerciaux aujourd’hui. Plusieurs entreprises de divers secteurs d’activités sont aujourd’hui présentes pour les résidents. Nombreuses d’entre elles répondent à des demandes actuelles de leur époque (ex. les produits agricoles du terroir). Les exemples sont abondants, et ces entreprises sont les témoins d’un dévouement de gens d’ici, mais aussi d’ailleurs.
L’agriculture modernisée, la fin d’une époque agricole dite « traditionnelle »[230]?
Comme il fut mentionné dans d’autres capsules, certains cultivateurs de la fin du XIXe et début XXe siècles ont spécialisé leur production agricole afin de tirer de meilleurs revenus. Ce processus de spécialisation s’accélère dès 1969 [231]. Ce « …nouveau phénomène… [232] » se fera progressivement aux quatre coins de la paroisse, et exigera entre autres des agriculteurs qu’ils aient des bâtiments répondant à leur(s) spécialisation(s) [233]. S’amorce alors à cette époque (depuis la fin des années 1960 environ) des transformations ou démolitions d’anciennes étables, la construction de bâtiments nouveaux, etc. L’architecture agricole extérieure traditionnelle se trouve de plus en plus changée. Par exemple, les revêtements de tôle supplantent les anciens recouvrements muraux de planches blanchies, « ocrées » rouges, ou bien « noires [234] »; les silos en ciment remplacent les silos de bois, etc. De plus, les proportions des bâtiments ne cessent de changer avec les années, certaines atteignent même aujourd’hui des largeurs et profondeurs immenses. Bref, le paysage agricole dit traditionnel se trouve changé depuis un petit peu plus d’un demi-siècle. Néanmoins, il y a des agriculteurs qui sont soucieux de préserver quelques éléments de leur patrimoine agricole ancien.
Brève histoire de l’éducation des jeunes depuis 1950
L’éducation des jeunes fut aussi mise au service de la modernité durant les années 1950. Deux écoles plus spacieuses ont été construites à cette époque, soit la future école Dominique-Savio (1952, pour les garçons, laquelle remplace alors l’école du village trop petite) et Thérèse-Martin (1956, pour les filles, car le couvent n’est alors plus en mesure de prendre toutes les filles) [235]. En 1969, la mixité est possible à toutes les années, garçons et filles peuvent désormais recevoir leur éducation primaire dans les mêmes classes de Dominique-Savio [236]. L’école Thérèse-Martin devient alors plus ou moins vacante après cette date, et elle a entre autres permis en 1980 [237] d’accueillir la première bibliothèque municipale.
Conclusion
L’histoire de la paroisse (municipalité) de Saint-Esprit évoquée tout au long des douze capsules vient démontrer qu’elle garde et préserve la mémoire d’une multitude de personnes qui ont vécu durant ses quelques 240 ans d’existence. Avant d’achever ce travail d’écriture, j’aimerais partager aux lecteurs une phrase que j’ai entendue souvent depuis plusieurs années, laquelle m’a guidé et inspiré à mieux comprendre l’histoire de Saint-Esprit. Je conclue en l’écrivant ici : Il en est passé du monde avant nous autres.
Textes intégral Guillaume Collin
RÉFÉRENCES ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
[1] « Mise en contexte socio-territorial : seigneuries, paroisses, municipalités et noyaux villageois ». PATRIMOINE BÉCANCOUR. Dir. Étude de caractérisation du territoire et des noyaux villageois de Ville de Bécancour. Section 2, 136p. http://patrimoinebecancour.com/uploads/section-2-f.pdf, consulté le 10 janvier 2021. (Page 28 consultée).
[2] LAHAISE, Robert. « LEGARDEUR DE REPENTIGNY, JEAN-BAPTISTE ». Dans Dictionnaire biographique du Canada. Université Laval/University of Toronto, 2003, vol. 2. http://www.biographi.ca/fr/bio/legardeur_de_repentigny_jean_baptiste_2F.html, consulté le 9 janvier 2021.
[3] BRYDEN, John. « MARTEL, RAYMOND ». Dans Dictionnaire biographique du Canada. Université Laval/University of Toronto, 2003, vol. 2, 2021. http://www.biographi.ca/fr/bio/martel_raymond_2F.html, consulté le 9 janvier 2021.
[4] MARTEL, Colombe. « REVUE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX SAINT-CÉSAIRE, ANGE-GARDIEN, SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD, ROUGEMONT ». PAR MONTS ET RIVIÈRE, vol. 25, 2 (2022).
https://www.quatrelieux.qc.ca/bulletin/Annees_bulletin/ORIGINAUX/2022/BULLETIN%20-%20FEVRIER%202022.pdf, consulté le 7 juillet 2023. (Page 9 consultée).
[5] Ibid., p. 9.
[6] DUBÉ, Paul-André. « LEGARDEUR DE REPENTIGNY, PIERRE ». Dans Dictionnaire biographique du Canada. Université Laval/University of Toronto, 2003, vol. 2.
http://www.biographi.ca/fr/bio/legardeur_de_repentigny_pierre_1657_1736_2F.html, consulté le 6 juillet 2023.
[7] COUILLARD DESPRÉS, Azarie. Histoire de la Famille et de la Seigneurie de Saint-Ours. Vol. 2. La Famille et la Paroisse de Saint-Ours : 1785-1916. Saint-Hyacinthe, A.-X. BERNARD, 1917, 473p. (Page 24 consultée).
[11] THUOT, Jean-René et SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN. Parcours de bâtisseurs à Saint-Roch-de-l’Achigan : Les lieux de mémoire revisités. Montréal, Archiv-Histo, 2006, 416p. (Page 21 consultée).
[13] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et THUOT, Jean-René. « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 ». ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008... Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, p. 19-45. (Page 22 consultée).
[15] Thuot, Parcours de bâtisseurs à Saint-Roch-de-l’Achigan, p. 21.
[16] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 16-17 consultées).
[17] C’est une hypothèse retenue par Estelle Brisson en 1983. Elle est plausible pour de courtes distances. Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 13-14.
[18] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et THUOT, Jean-René. « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 ». ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008... Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, p. 19-45. (Pages 22-23 consultées).
[19] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et THUOT, Jean-René. « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 ». ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008... Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, p. 19-45. (Page 24 consultée).
[20] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Page 15 consultée).
[21] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance et le développement de la communauté de Saint-Esprit », p. 25-26.
[23] THUOT, Jean-René et SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN. Parcours de bâtisseurs à Saint-Roch-de-l’Achigan : Les lieux de mémoire revisités. Montréal, Archiv-Histo, 2006, 416p. (Page 82 consultée).
[24] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance et le développement de la communauté de Saint-Esprit », p. 29.
[26] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 10.
[27] Celui-ci se doit de conserver le bon ordre et la paix dans la concession. Voir : Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance et le développement de la communauté de Saint-Esprit », p. 29.
[30] Il s’agit également d’un moulin à scie. Voir : Ibid., p. 24.
[31] Information tirée de : ACEJ, « lettre de Paul-Roch de Saint-Ours à Monseigneur », dans Dossier de la correspondance des curés de Saint-Esprit, 15 octobre 1797, document d’archive reproduit par Estelle Brisson dans : BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 285-286 consultées).
[32] Voir le plan dans : Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance et le développement de la communauté de Saint-Esprit », p. 30-31.
[33] Pour en savoir plus sur la vente des chemins, voir : Ibid., p. 32.
[35] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 22 à 26 consultées).
[38] Voir la description de ce dossier : BANQ. « Détail de la notice - Saint-Ours-du-Saint-Esprit (Saint-Esprit) - 13 septembre 1800 - 20 décembre 1887 », dans BANQ, dir., Bibliothèque et Archives nationales du Québec. https://advitam.banq.qc.ca/notice/499554 (Page consultée le 3 mars 2021).
[39] FARIBAULT, Joseph-Édouard. « Marchez de la Maconne de l’Eglise et Sachristy de la Nouvelle paroisse de St. Esprit », dans Joseph-Édouard Faribault - 1791-1849, Montréal, BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Cour supérieure - District judiciaire de Joliette - Greffes de notaires, 16 octobre 1802, CN605,S18.
[43] Ibid. La minceur au sommet des murs est causée par le fruit. Le fruit, dans ce cas-ci, signifie que les murs penchent seulement à l’extérieur. Cela provient de la tradition architecturale venant du régime français canadien.
[46] FARIBAULT, Joseph-Édouard. « Marché d’ouvrages de charpenterie d’une église située en la côte du Grand Saint-Esprit, seigneurie de monsieur Saint-Ours entre Pierre Dufour dit Latour, maître charpentier, de la paroisse de Lavaltrie; et Julien Beaupré et Joseph Courtemanche », dans Joseph-Édouard Faribault : 1791-1849, Montréal, BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Cour supérieure - District judiciaire de Joliette - Greffes de notaires, 2 février 1804, CN605,S18/mic.# M-349.154. La transcription de l'acte a été effectuée par M. Jules Guérard - gracieuseté de Jean-René Thuot.
[47] Ibid. Toutes ces informations se retrouvent dans le marché du 2 février 1804.
[49] Information tirée de : DE SAINT-OURS, Paul-Roch. « Lettre du Sieur de St-Ours à l’Évêque de Québec : 18 juillet 1806 », 10 juillet 1806, document d’archive reproduit par Estelle Brisson dans : Brisson, op. cit., p. 286-287.
[54] Il s’agit approximativement du nombre d’arpents défrichés en une année par un colon à cette époque : LA FÉDÉRATION DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE LANAUDIÈRE. Pour que vivent bêtes et gens. Joliette, Imprimerie Housseaux, 1984, 211p. (Page 32 consultée).
[55] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et THUOT, Jean-René. « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 ». ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008... Dir. Saint-Esprit: 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, p. 19-45. (Page 31 consultée).
[56] Les Éditions du Boréal, Paul-Louis Martin, [En ligne],
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/auteurs/paul-louis-martin-11371.html >, (page consultée le 4 juillet 2023).
[57] MARTIN, Paul-Louis. « "À la façon du temps présent" Trois siècles d'architecture populaire au Québec ». Réseau, no. 8, vol. 30 (mai 1999).
https://www.uquebec.ca/bap/bap/mag_reseau/mag99_05/99_05.html, consulté le 5 mai 2021.
[58] MARTIN, Paul-Louis. À la façon du temps présent : Trois siècles d'architecture populaire au Québec. Québec (ville), Les Presses du l’Université Laval, 1999, 378p. (Page 71 consultée).
[60] MARTIN, Paul-Louis. « "À la façon du temps présent" Trois siècles d'architecture populaire au Québec ».
[62] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 16 consultée).
[66] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance et le développement de la communauté de Saint-Esprit », p. 33.
[69] WYNN, Graeme. « Histoire du commerce du bois ». Dans L'Encyclopédie Canadienne, Historica Canada, 24 juillet 2015. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-du-commerce-du-bois-1, consulté le 5 mai 2021.
[70] Ibid.
[71] FARIBAULT, J-M., RICHOT, Jean-Bte et LES HABITANTS DE ST-ESPRIT. « Supplique des habitans de St-Esprit à l’Evêque de Québec », 15 septembre 1811, document d’archive reproduit par Estelle Brisson dans : Brisson, op. cit., p. 289-292.
[74] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 36.
[76] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance et le développement de la communauté de Saint-Esprit », p. 36.
[78] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 37 consultée).
[79] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et THUOT, Jean-René. « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 ». ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, p. 19-45. (Page 34 consultée).
[80] Ibid.
[81] JOYAL, Serge. « L’École de Quévillon dans la région de Lanaudière ». Sessions d'étude - Société canadienne d'histoire de l'Église catholique, vol. 54 (1987), p. 117–129. https://www.erudit.org/en/journals/sessions/1900-v1-n1-sessions1827137/1006966ar.pdf, consulté le 5 juin 2021. (Page consultée 124).
[82] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. « Naissance et développement de la paroisse de Saint-Esprit ». ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, p. 48-71. (Page 48-49 consultée).
[83] DESSUREAULT, Christian. « Les syndics scolaires du district de Montréal (1829-1836) : une sociographie des élus ». Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 63, no. 1 (été 2009), p. 33-81. (Page 33 consultée).
[84] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 », p. 37-38.
[86] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 137 consultée).
[88] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 138.
[89] BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. 8 avril 2020. Recherche : Recensement de 1831, Bas-Canada (Québec), [En ligne],
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recensements/1831/Pages/1831.aspx , (page consultée le 5 juin 2021).
[90] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 48.
[91] Bibliothèque et Archives Canada, Recherche : Recensement de 1831, Bas-Canada (Québec).
[92] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 », p. 35.
[94] Bibliothèque et Archives Canada, Recherche : Recensement de 1831, Bas-Canada (Québec).
[97] ROY, Fernande. « Patriotes ». Dans l'Encyclopédie Canadienne, Historica Canada, 4 mars 2015. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/patriotes, consulté le 5 juin 2021.
[98] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867», p. 38.
[101] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 95.
[102] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 », p. 38.
[103] Ibid., p. 38.
[104] BELLENGER, Joseph-Marie. « Lettre du curé Bellenger à Mgr de Montréal », 7 janvier 1838, document d’archive reproduit par Estelle Brisson dans : Brisson, op. cit., p. 311-312.
[105] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 73.
[106] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 », p. 35.
[107] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 77-78.
[109] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et THUOT, Jean-René. « La naissance de la communauté de Saint-Esprit : 1767-1867 ». ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, p. 19-45. (Page 41 consultée).
[110] CARELESS, James Maurice Stockford. « Province du Canada, 1841-67 ». Dans l'Encyclopédie Canadienne, Historica Canada, 27 septembre 2019.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/province-du-canada-1, consulté le 4 juillet 2021.
[111] Ibid.
[112] Équipe Archiv-Histo et Thuot, « La naissance de la communauté de Saint-Esprit, 1767-1867», p. 39.
[118] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 86-87 consultées).
[120] CHARRON, Michel. « Lettre du curé Charron à Mgr Bourget, Evêque de Montréal, 12 août 1849 », 12 août 1849, document d’archive reproduit par Estelle Brisson dans : Brisson, op. cit., p. 89.
[121] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 89.
[125] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO. « Naissance et développement de la paroisse de Saint-Esprit ». Denis RACINE et al., dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008, p. 48-71. (Page 55 consultée).
[127] CHARRON, Michel. « Rapport sur la paroisse du St-Esprit par le curé Charron pour Mgr Bourget, Evêque de Montréal, _ _ _ 1861 », 1861, document d’archive reproduit par Estelle Brisson dans : Brisson, op. cit., p. 102-103.
[128] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 44.
[131] Équipe Archiv-Histo et al., « Naissance et développement de la paroisse de Saint-Esprit », p. 57.
[132] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 105.
[133] BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. 9 septembre 2020. Recherche : Recensement de 1861, Bas-Canada (Québec), [En ligne], < https://central.bac-lac.gc.ca/.item/?app=Census1861&op=&img&id=4108795_00308 >, (page consultée le 4 juillet 2021).
[134] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 14
[135] Estelle Brisson avance que le ¾ de la population durant la période 1850-1900 cultivait la terre. BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Page 127 consultée).
[136] Pour plus d’informations sur l’histoire de la commercialisation des produits agricoles à Saint-Esprit, voir : Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 49-55.
[137] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO. « L’évolution de l’institution municipale à Saint-Esprit ». Denis RACINE et al., dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008, p. 74-97. (Page 78 consultée).
[138] BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. 9 septembre 2020. Recherche : Recensement de 1861, Bas-Canada (Québec), [En ligne],
< https://central.bac-lac.gc.ca/.item/?app=Census1861&op=&img&id=4108795_00311 >, (page consultée le 8 août 2021).
[139] Équipe Archiv-Histo et al., « L’évolution de l’institution municipale à Saint-Esprit », p. 78.
[141] Ce moulin était situé dans l’actuelle rue du moulin, et ce qui en restait fut démoli en 2014.
[142] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 159.
[147] Citation formulée par Estelle Brisson dans le livre suivant : Ibid., p.123.
[149] Deux ont été repérés dans le recensement de 1871. Les deux autres sont été trouvés dans : Ibid., p. 124.
[156] Saint-Ours du Saint-Esprit de Montcalm : 150e 1808-1958. Joliette, Imprimerie Saint-Viateur, 1958, 91p. (Page consultée 32).
[160] LOVELL, John et fils. Lovell's business and professional directory of the province of Quebec for ... : 1890-91.
Montreal, John Lovell & Son, 1890, 1054 pages. (Page 508 consultée).
[161] Ibid.
[162] BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. 9 septembre 2020. Recherche : Recensement de 1891, Bas-Canada (Québec), [En ligne],
< https://central.bac-lac.gc.ca/.item/?app=Census1891&op=img&id=30953_148206-00364 >, (page consultée le 4 septembre 2021).
[163] UPA LANAUDIÈRE. Pour que vivent bêtes et gens. Joliette, Imprimerie Housseaux inc., 1984, 200p. (Page consultée 64).
[168] J’invite le lecteur à consulter cette page d’archive, car il se trouve sur celle-ci des dessins de bâtiments d’époque. Voir : « Saint-Esprit : L’une des plus riches paroisses de Montcalm ». La patrie (Montréal), no. 173 (17 septembre 1898), 16p.
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4313000, consulté le 4 septembre 2021. (Page consultée 1).
[169] ROCHON, Pascal. Le patrimoine de Saint-Esprit : Notre héritage, notre avenir. Saint-Esprit, 2016, 43p. (Page consultée 15).
[170] Ibid., p. 15.
[171] « Saint-Esprit : L’une des plus riches paroisses de Montcalm », p. 1.
[174] La photo sur ces pages montre cette auberge: Denis RACINE et al. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008, p. 48-71. (Pages 46-47 consultées).
[175] Pascal Rochon, Le patrimoine de Saint-Esprit : Notre héritage, notre avenir, p. 16.
[176] En exemple, James Smart Manufacturing co à Brockville, Ontario, vend des machines à manivelles et à pédales pour travailler le bois. Voir le catalogue de 1885, p. 143-146 : INTERNET ARCHIVE, 6 juillet 2011, Hardware catalogue, 1885 [microform], [En ligne],
< https://archive.org/details/cihm_89431/page/n157/mode/2up >, (page consultée le 7 septembre 2021).
[177] Errata : La capsule du mois d’avril 2021 portant sur la première église disait que la construction d’icelle s’est terminée en 1806. Ce n’est pas tout à fait vrai, la fin du « gros œuvre » se serait terminé soit à la fin de l’année 1804 ou bien au printemps (été?) 1805. Le seigneur Paul-Roch de Saint-Ours mentionne dans une lettre du 10 juillet 1806 que « …[les] habitans (sic) […] ont réussies (sic) à faire une très belle église … », cité dans : DE SAINT-OURS, Paul-Roch. « Lettre du Sieur de St-Ours à l’Evêque de Québec : 10 juillet 1806 »,1806, document d’archive reproduit par Estelle Brisson dans : BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Page 286 consultée).
[179] NOPPEN, Luc. Les églises du Québec (1600-1850). Montréal, Éditeur officiel du Québec / FIDES, 1977, 298p. (Page 39 consultée).
[180] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p.191.
[181] Estelle Brisson ne mentionne que le style néo-gothique. Voir: Ibid., p. 196.
[185] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO. « Naissance et développement de la paroisse de Saint-Esprit ». Denis RACINE et al., dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008, p. 48-71. (Page 67 consultée).
[186] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 246-7.
[192] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO. « L’évolution de l’institution municipale à Saint-Esprit ». Denis RACINE et al., dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008, p. 74-97. (Page 78 consultée).
[193] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Page 177-178 consultées).
[197] UPA LANAUDIÈRE. Pour que vivent bêtes et gens. Joliette, Imprimerie Housseaux inc., 1984, 200p. (Page consultée 73).
[199] Équipe Archiv-Histo, « L’évolution de l’institution municipale à Saint-Esprit », p.79.
[203] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p.55.
[204] Équipe Archiv-Histo, « L’évolution de l’institution municipale à Saint-Esprit », p.79.
[205] Estelle Brisson en dit davantage sur les types d’artisans nommés ici. Voir : Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 164-174.
[206] Estelle Brisson en dit davantage sur les types de commerces spécialisés nommés ici. Voir : Ibid., p. 174, 213-223.
[207]Estelle Brisson en dit davantage sur les types de professionnels nommés ici. Voir: Ibid., p. 232-240.
[213] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO. « Naissance et développement de la paroisse de Saint-Esprit ». Denis RACINE et al., dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008, p. 48-71. (Page 62 consultée).
[216] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 246.
[221] Renseignements M. Martial Collin.
[222] DORION, Marie-Josée. « L’électrification du monde rural québécois ». Revue d’histoire de l’Amérique française, 54, 1 (2000), p. 3-37. (Page consultée 24).
[223] Le livre du bicentenaire de la paroisse est tout à propos pour mieux comprendre la période 1950-2008. Voir : ÉQUIPE ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, 522p.
[224] Saint-Ours du Saint-Esprit de Montcalm : 150e 1808-1958. Joliette, Imprimerie Saint-Viateur, 1958, 91p. (Page consultée 85).
[225] BUSSEAU, Laurent. « Guido Nincheri : le savoir-faire de la Renaissance italienne à Montréal». Histoire Québec, 22, 4 (2017), p.14–16. (Page consultée 14).
[227] « Les organismes et les commerces de la municipalité de Saint-Esprit ». ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, 522p. (Page 477 consultée) Chorale de l’église, d’hier à aujourd’hui.
[228] « Les organismes et les commerces de la municipalité de Saint-Esprit ». ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, 522p. (Page 484 consultée) La Fabrique de Saint-Esprit.
[229] Voir les nombreuses publicités montrées dans le livre souvenir du 150e anniversaire de la paroisse de Saint-Esprit : Saint-Ours du Saint-Esprit de Montcalm : 150e 1808-1958, 91p.
[230] ÉQUIPE ARCHIV-HISTO. « En route vers la modernisation ». Denis RACINE et al., dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008, p. 100-119. (Page 106 consultée).
[231] Ibid., p. 106.
[233] De ces spécialisations, les plus répandues étaient en 1998 la production laitière, porcine, et de poulets à griller. Voir : Équipe Archiv-Histo, « En route vers la modernisation », p. 106. Toutefois, la production laitière est beaucoup moins répandue en 2021.
[234] Planches restées sur le bois naturel ou bien qui n’ont pas été chaulées ou « ocrées » depuis plusieurs (plusieurs!) années. Le soleil, le vent et la poussière sont autant d’éléments qui contribuent à créer cet aspect plus ou moins foncé.
[235] « Les organismes et les commerces de la municipalité de Saint-Esprit ». ARCHIV-HISTO et al. Dir. Saint-Esprit : 1808-2008. Montréal, Archiv-Histo, 2008, 522p. (Page 480-481 consultées) École Dominique-Savio 1952 : École Thérèse-Martin 1956.
[237] Ibid., p. 480-48.
-
Les bâtisseurs
Pour découvrir l'histoire de nos Bâtisseurs, suivez ce lien :
Municipalité | Découvrir | Hommage aux Bâtisseurs Municipalité de Saint-Esprit
-
L'agriculture et l'acériculture
L'agriculture et l'acériculture
ÉRABLIÈRES
Dès le début de la colonisation de Saint-Esprit, les colons découvrirent que les forêts renfermaient des érablières très productives. En peu de temps, les érablières devinrent une source de profit très intéressante, car les produits d’érable étaient très en demande dans les marchés des villes. Au printemps, rien ne pouvait empêcher les colons de se rendre aux érablières et de faire bouillir la sève jour et nuit, même le dimanche, ce qui provoquait l’indignation du curé. Même après maintes menaces et plusieurs rapports à l’évêque de Québec, le curé dû se rendre à l’évidence que rien ne pouvait changer l’attitude des colons. Il dû alors adapter le calendrier des fêtes religieuses à cet évènement printanier.

Jean-Denis Perreault aux sucresDans les années 1920, les premiers repas de cabane à sucre sont offerts par plusieurs agriculteurs. Très populaire auprès des gens de la ville, ce repas traditionnel attirait plusieurs personnalités importantes dont l’ancien maire de Montréal, Camilien Houde. Les produits d’érable transformés sont écoulés rapidement à chaque saison. Les producteurs maraîchers et de produits de l'érable vendent leurs produits tout au long de la route 125, créant ainsi une ambiance particulièrement vivante. Les produits de l’érable constituent une source de revenus complémentaires pour plusieurs cultivateurs du territoire. Saint-Esprit est à cet effet considéré aujourd’hui comme la capitale des érablières dans la région de Lanaudière.
AGRICULTURE
Territoire principalement agricole, l’agriculture a toujours fait partie de Saint-Esprit. Avec le temps, les agriculteurs sont passés de la subsistance, à la productivité et la rentabilité. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les principales cultures sont le foin, l’orge, le sarrasin et le tabac. L’élevage de porcs, volailles et lapins sont également présents.


À compter de 1875, on assiste à une réorientation de l’agriculture. La culture de tabac à pipe et à cigare devient la principale richesse de la paroisse. L’industrie laitière est davantage présente au sein des fermes de Saint-Esprit. Par la suite, l’élevage porcin et la culture du grain prennent également de l’ampleur.
Les agriculteurs prennent en main cette expansion et créent successivement la Coopérative de beurre, la Coopérative de tabac de Montcalm, l’Abattoir Montcalm et la Société Coopérative Agricole de Montcalm.

Séchoir à tabac
René Trudel - culture de tabacMeuneries
Meunerie Henri
Vers 1950, une boulangerie avait pignon sur la rue St-Louis. Afin de répondre à la demande de son établissement, le propriétaire M. Édouard Henri établit une petite meunerie à l’arrière de la boulangerie afin de moudre lui-même diverses céréales. Victime de sa popularité, la demande fut si importante qu’il dû construire une nouvelle meunerie beaucoup plus grande, non loin sur la rue Principale. Il conserva cet établissement jusqu’en 1968 où M. Jean-Paul Pitre se porta acquéreur. [i]
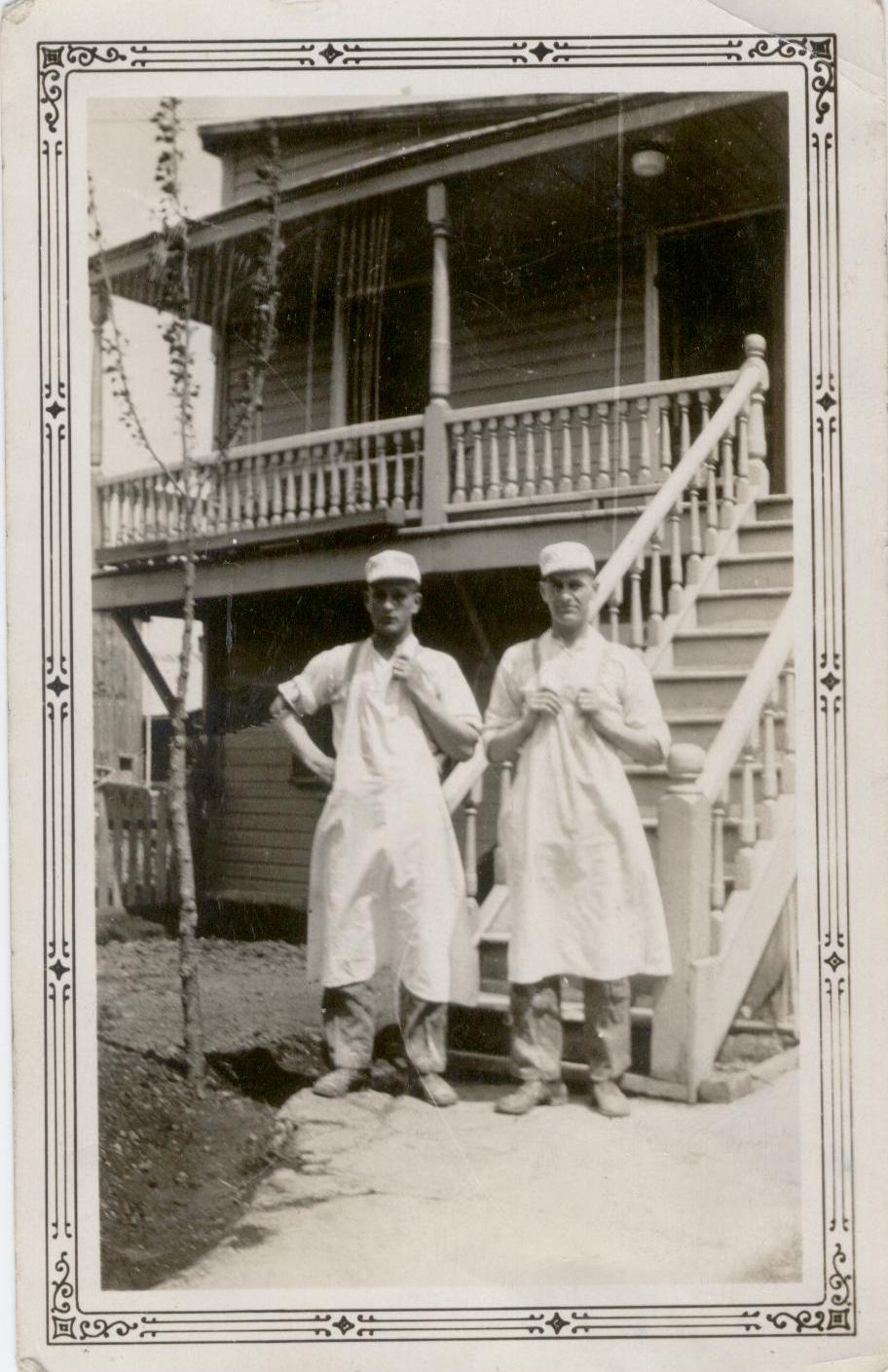
Edouard Henri - Boulangerie Première meunerie
Première meunerie
Meunerie Coopérative Agricole de Montcalm

Une autre meunerie connût beaucoup de succès à Saint-Esprit, soit la Coopérative Agricole de Montcalm. Cette coopérative fût créée afin de réponde aux besoins grandissants des agriculteurs. En effet, au début des années 40, la culture des céréales prend beaucoup d’expansion. Malheureusement, la fermeture du moulin d’Hermas Raymond complique la réalité des cultivateurs qui n’ont plus accès à un moulin à moudre. Ces derniers s’unissent donc aux cultivateurs de St-Roch et de Ste-Julienne afin de créer une meunerie coopérative. La première assemblée des membres nomme Antonio Desroches à titre de président. Dès 1947, on procède à la construction du bâtiment permettant de cribler et désinfecter les semences dans une section et de vendre semences, engrais, instruments et articles de quincailleries dans une autre. En 1975, la coopérative s’associe à celle de St-Jacques pour devenir la Coopérative Agricole de Montcalm. [ii]
La manufacture de tabac - 104 rue Principale
L’agriculture a toujours fait partie de Saint-Esprit. Avec le temps, les agriculteurs sont passés de la subsistance, à la productivité et la rentabilité.
En 1875, on assiste à une réorientation de l’agriculture. La culture de tabac à pipe et à cigare devient la principale richesse de la paroisse. Nécessitant plus de travail, mais étant très rentable, cette culture représente une source de revenus importante permettant d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs.
 Compagnie de tabac
Compagnie de tabacLa Compagnie de Tabac de Montcalm fût créée au début du siècle par Euclide Lapalme dans la maison actuellement située au 104 Principale. La compagnie achetait les récoltes des cultivateurs pour ensuite faire le tri des feuilles et les hacher. La production était ensuite vendue aux manufactures de cigarettes, cigares et tabac à pipe de Montréal. Plusieurs publicités dans les journaux locaux ont permis d’accroitre la popularité de cette entreprise. Elle ferma ses portes dans les années trente, s’inclinant devant la compétition de la Coopérative de tabac de St-Jacques [iii].
Le bâtiment est toujours existant et, malgré les changements effectués aux cours des années, la structure demeure sensiblement la même.

La beurrerie du village - 29 rue Saint-Louis

À Saint-Esprit on trouvait, au début 1900, quelques petites beurreries, toutes situées à l’extérieur du village. Avec l’expansion des fermes laitières, le besoin était grandissant pour une beurrerie plus importante dans le cœur du village. Le terme beurrerie défini l’établissement équipé d’appareils convenables dédiés à la transformation du lait ou de la crème de cinquante vaches ou plus, comparativement aux laiteries qui traitent le lait ou la crème de moins de cinquante vaches. Puisque le système de ramassage de la crème en bidons gagne en faveur, en 1910 aura lieu l’ouverture d’une beurrerie sur la rue Saint-Louis.
Lors de l’ouverture, le « premier homme de lait », celui responsable d’aller recueillir le lait chez les cultivateurs, est monsieur Fridolin Lamarche. Le poste de beurrier est alors occupé par monsieur Versailles. Vers les années trente, dû aux problèmes d’écoulement des produits laitiers, est créée la Coopérative de beurre, regroupant plus de 200 membres des municipalités avoisinantes. Cette coopérative s’installe dans la beurrerie de la rue Saint-Louis, afin de transformer le lait en beurre, l’emballer en moules d’une livre, pour ensuite le vendre à des compagnies [iv]. Chaque livre de beurre est enveloppée dans du papier parchemin à l’effigie de la beurrerie. Pour l’exportation, le beurre est déposé dans des boîtes carrées en bois de 56 livres, communément appelées « boîtes à beurre », que l’on expédie toutes les semaines vers les marchés centraux. La beurrerie sera en fonction jusqu’aux années soixante environ.

[i] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 230-231 consultées).
[ii] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 229-230 consultées).
[iii] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 177-179 consultées).
[iv] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages consultées 156-157 et 226-229).
Contenu et texte © Pascal Rochon
-
Les bâtiments religieux
L’ÉGLISE
 1ere église
1ere église
Première église
Construite entre 1805 et 1809 selon les plans de Pierre Conefroy, la première église en forme de croix latine est de petite dimension et très modeste. Faite de pierres des champs grossièrement équarries, elle fut couverte d'une toiture de planches et surmontée d'un clocher en flèche. Cette petite église de pierre a vécu des sinistres majeurs au cours des années, dont un ouragan en 1841 qui fit basculer le clocher dans l’église, ainsi qu’un incendie à la fin du XIX siècle. Considérant la détérioration de son état et la difficulté à accueillir les paroissiens, en raison de l’augmentation de la population, la décision fut prise en 1901 de la démolir.

Deuxième église




La deuxième église est érigée en 1902. De style néo-gothique, dotée d’un clocher à double clocheton et d’un intérieur richement décoré, elle fut considérée comme le joyau et l’une des plus belles du diocèse de Joliette. Malheureusement, après seulement 29 ans d’existence, l’église fut rasée par un incendie le 9 mai 1931.
L'incendie
Le soir du 9 mai, quand les dernières personnes quittèrent l’église, rien d’anormal n’était visible. Vers 21h15, un voisin de l’église aperçu des lueurs orangées à travers les fenêtres. L’alerte fut rapidement lancée. Les prêtres et citoyens essayèrent de sauver les saintes espèces, mais la fumée étant très dense, ils durent rebrousser chemin. Comble de malheur, la pompe d’incendie s’enrailla et il fallut quinze minutes pour la redémarrer. Le feu s’était déjà répandu dans toute l’église. Les cloches sonnèrent sans arrêt, afin d’alerter les citoyens, jusqu’à ce que le clocher s’effondre. Le lendemain, les paroissiens n’avaient qu’une image désolante des ruines encore fumantes de leur église. Les messes suivantes furent données dans le 2e étage de l’auberge. Les dommages furent estimés à 200 000$. À l’époque, plusieurs journaux parlent de l’évènement. La Presse mentionne que le feu aurait été allumé par une main criminelle, car trois semaines auparavant, M. le Curé aurait reçu l’appel d’un inconnu qui lui aurait dit que « quelque chose allait arriver samedi soir ». Le curé fait alors surveiller l’église deux samedis consécutifs, mais comme rien ne s’était produit, aucun garde n’était présent le samedi fatidique suivant. Par la suite, M. le Curé démenti cette nouvelle de La Presse, ajoutant que tout aurait été inventé par le journal.


Troisième église
La construction de l’église actuelle débuta en 1931 et fut achevée en 1933. La décoration intérieure ne fut réalisée que dix-sept ans plus tard. Afin d’éviter de revivre la même situation que la 2e église, cette dernière fut construite entièrement de béton. Les toiles qui s’y trouvent sont l’œuvre du maître italien Guido Nincheri. Cet artiste a également décoré la maison Dufresne, appelée le château Dufresne, à Montréal. La sacristie fut reproduite identique à celle de la deuxième église.


Les presbytères : 81 Saint-Isidore
Trois presbytères furent construits à Saint-Esprit. Nécessaires à la venue d’un premier curé résidant, le curé Périneault, les colons entreprirent les travaux d’un premier presbytère à l’automne 1818. À cette époque, le travail au champ monopolisait énormément de temps, ce qui rallongea la durée des travaux qui ne se terminèrent qu’en 1819. Construit à la mode française, avec cheminée en pierres centrale, ladite bâtisse était en pierres des champs, recouverte d’un toit en bois. Très modeste et non adapté au climat québécois, elle ne résista pas longtemps aux intempéries, et soixante-sept ans plus tard, un nouveau presbytère était requis. Il n’existe malheureusement pas d’image de ce dernier. [i]
Le second, construit en 1886 fut sera fait de pierres de taille et richement décoré. Un magnifique jardin de fleur s’y trouvait autour d’une statue de la Sainte-Vierge.
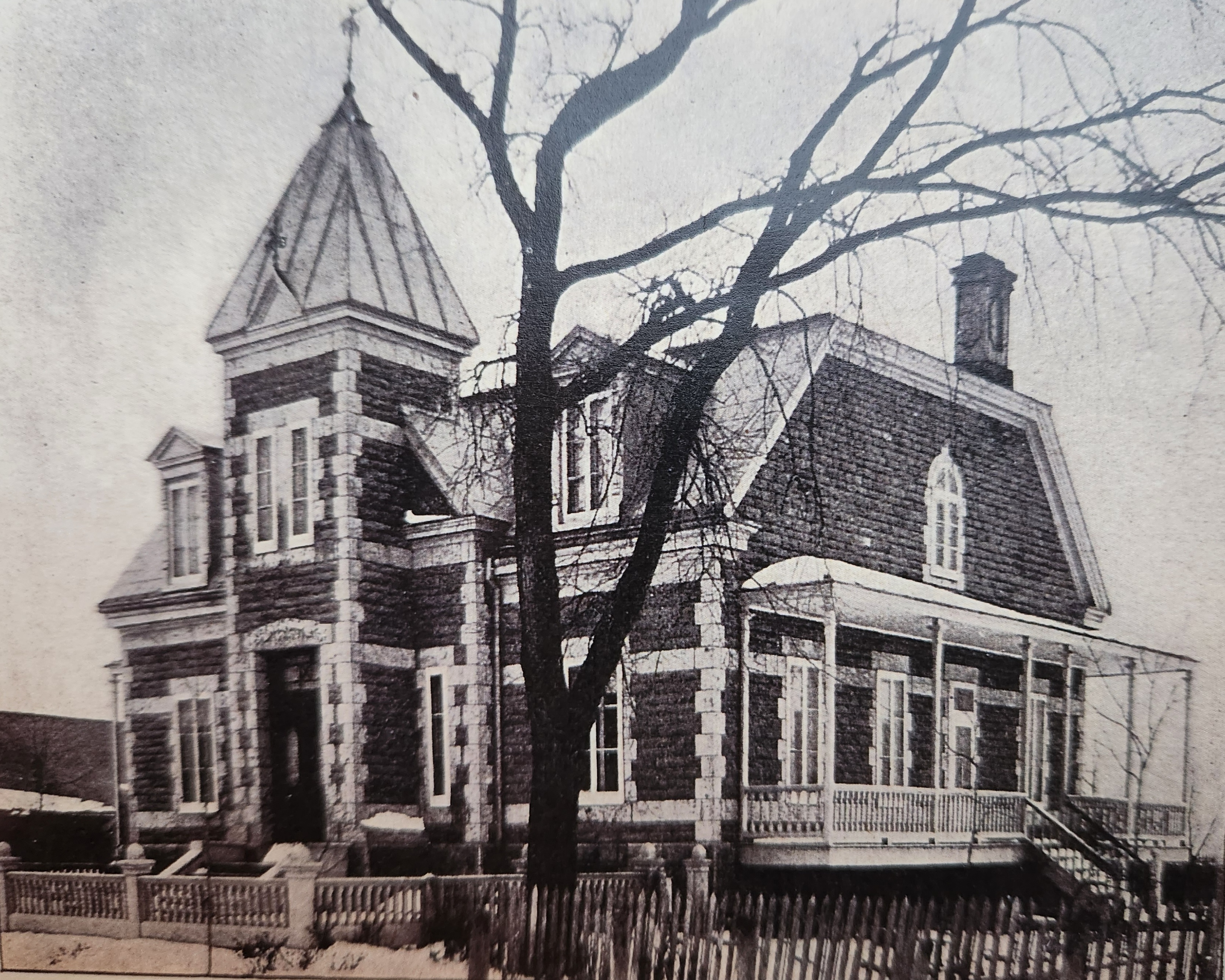

Au cours des année 60, le presbytère nécessita d’importantes réparations. La fabrique prit alors la décision de le remplacer par un nouveau plus moderne qui fut construit en 1967. Durant les dernières années, c’est la caisse populaire Desjardins qui l’occupa. [ii]
LE CIMETÈRE, LE CHARNIER ET LES CROIX
 Cimetière et charnier ©Pascal Rochon
Cimetière et charnier ©Pascal Rochon
Le cimetière original était situé près de la première église. En 1901, lors de la construction de la nouvelle église, le cimetière est déplacé sur des terrains avoisinants la rue Grégoire. La fabrique en profita pour construire le charnier actuel. Ce dernier possède un toit de tôle à la canadienne
Plusieurs croix ont été érigées dans les rangs de la municipalité et constituent un patrimoine précieux. De nature religieuses à l’origine, les croix de chemin sont aujourd’hui également un bien patrimonial qui apporte un cachet unique dans nos campagne québécoise et demeure le reflet de la foi de nos ancêtres. Elles sont un symbole qui souligne la forte appartenance religieuse du peuple québécois à une certaine époque. Certaines croix furent implantées pour assurer de bonnes récoltes, d’autres comme lieu de rassemblement et de prière. On peut classer les croix de chemin selon 3 modèles :
1) La croix de chemin simple : Poteau et traverse avec parfois des éléments décoratifs aux extrémités.

Face au 51 rang Rivière nord © Francine Vendette2) La croix aux instruments de la passion : Sur la traverse on retrouve généralement des objets symboliques qui peuvent varier tels que la lance, l’éponge, le marteau, les clous, la couronne d’épines, etc.

St-Isidore et des Continuations © Francine Vendette
3) Le calvaire : représente le Christ en croix. Il est parfois surmonté d’un édicule. La Vierge et l’apôtre Jean se retrouvent à l’occasion au pied de la croix.

Cimetière © Francine VendetteStatuts du Sacré-Cœur
Le culte au Sacré-Cœur, consacré en 1685, est devenu populaire à la fin du XIXe siècle. Parfois réduit à un simple cœur enflammé ou irradiant, le Sacré-Coeur est cependant plus souvent représenté sur la poitrine du Christ, qui lui est représenté en buste ou en plein pied. Il est souvent illustré avec les mains et les bras ouverts dans un signe d’accueil ou avec les mains sur la poitrine désignant son cœur.


© Francine Vendette
[i] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages p. 133-136 consultées).
[ii] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 252.
ANCIEN COUVENT
Les sœurs de Sainte-Anne s’installent dans un premier couvent en 1876 dans la maison de Jean Baptiste Visinat. Cette maison de pierre de style français à toit raide, percée de lucarnes et traversée par une cheminée centrale, comporte une annexe en bois qui sert de salle de récréation. Un second couvent est construit en 1894. Ce bâtiment de trois étages est doté d’un toit français et d’un clocheton et sera utilisé par les sœurs jusqu’en 1970. Le couvent sera ensuite démoli en 1980 pour faire place à l’Office d’habitation de Saint-Esprit.
Contenu et texte © Pascal Rochon


-
Le couvent et l'éducation
Le couvent et l’éducation
Les Sœurs de Sainte-Anne sont une congrégation religieuse fondée en 1850 à Vaudreuil (Québec), par la servante de Dieu Marie-Esther Sureau, dite Blondin (Surnommée Mère Marie-Anne), dont la vocation est l'éducation des jeunes en milieu rural et autres œuvres de miséricorde.
Les Sœurs de Sainte-Anne ont une longue histoire d'engagement envers l'éducation des enfants partout dans le monde. Elles œuvrent à leur permettre un développement personnel et spirituel, des opportunités de carrière et un rayonnement comme citoyens.

 Première école
Première école deuxième couvent
deuxième couvent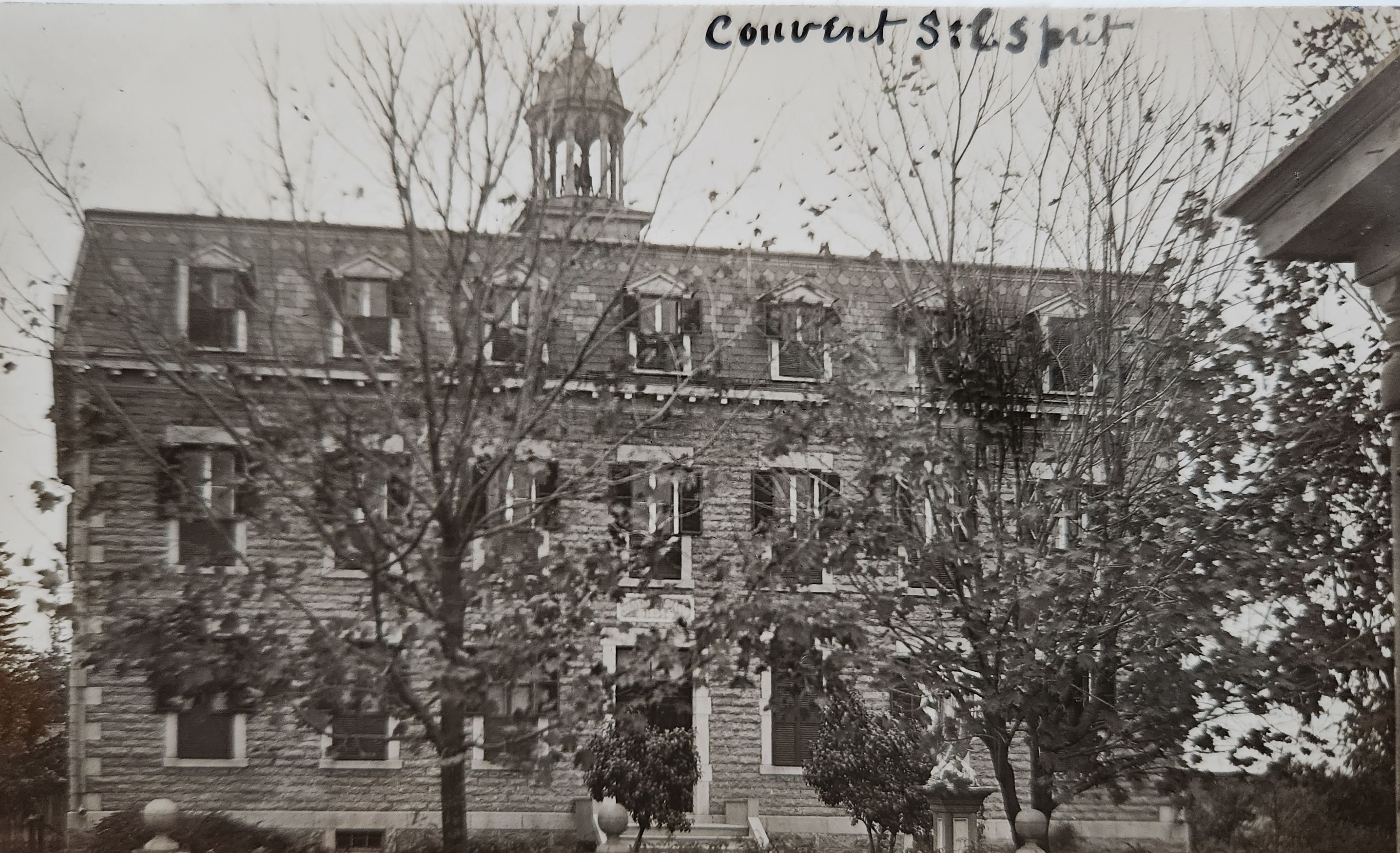
Le couvent et l’éducation desservie par les Sœurs de Sainte-Anne étaient bien accueillis par les paroissiens. Avec son excellente réputation, le couvent attirait non seulement des filles de Saint-Esprit, mais avait également une envergure régionale. Un agrandissement sera alors nécessaire pour répondre à la demande. Une annexe y sera construite en 1958. On y installera l’école ménagère, où les jeunes filles apprennent à être de parfaites maîtresses de maison… Une autre époque!
 École Dominique-Savio
École Dominique-SavioContenu et texte © Pascal Rochon
-
Le magasin général et l'hôtel
 Premier hôtel
Premier hôtel Auberge Victoria
Auberge Victoria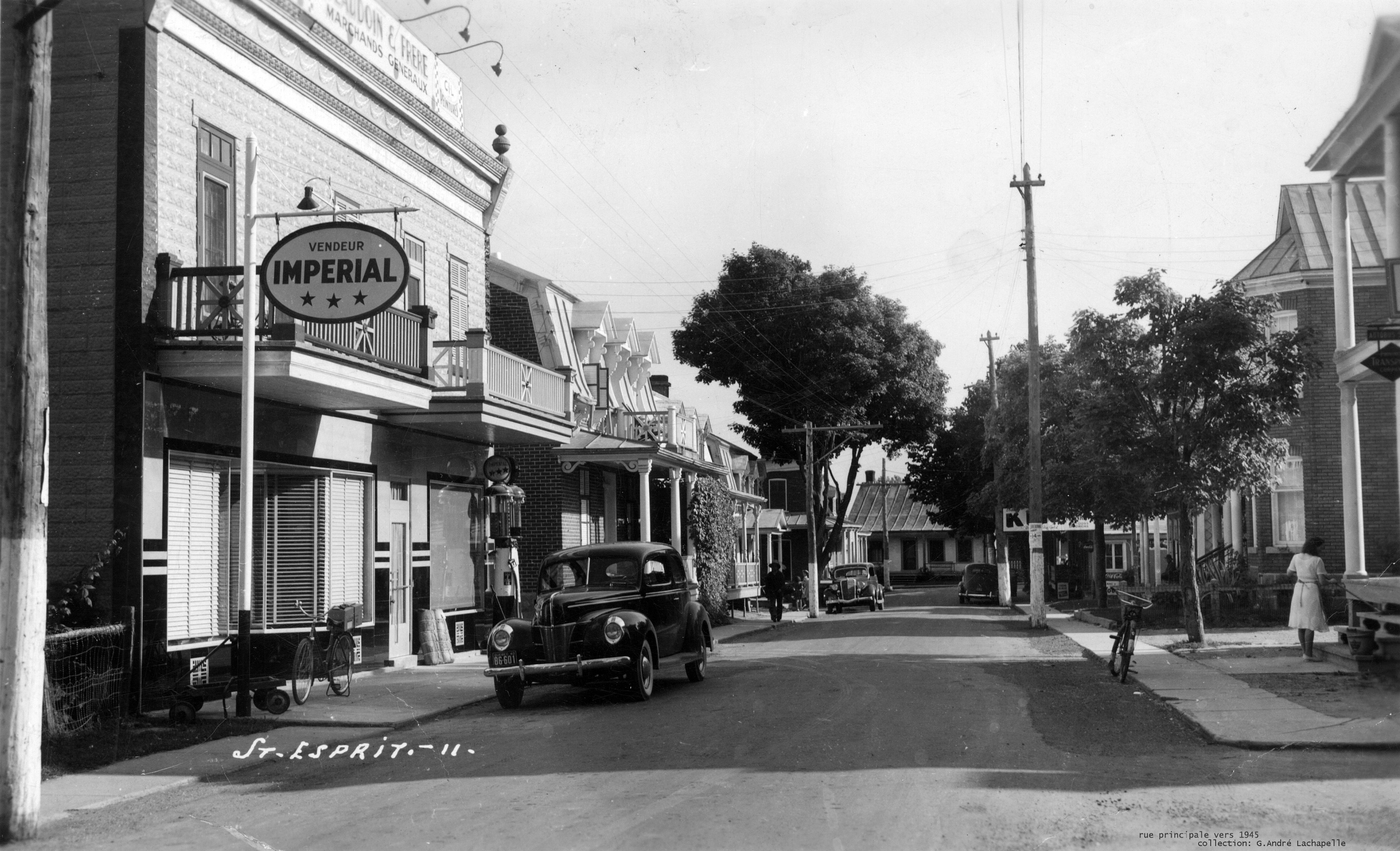 Magasin général
Magasin généralAu coeur du Village...
La maison du notaire - 60 rue Principale
Cette maison de fut construite par le notaire Joseph-Ferdinand Daniel, afin d’y installer son étude de notaire et une filiale de la Banque Canadienne Nationale. Le notaire Daniel occupa plusieurs postes importants dans le milieu municipal, fut l’un des propriétaires de la Compagnie de tabac de Montcalm et directeur de la compagnie d’électricité Québec Southern Power Corporation.
En 1940, un autre notaire important à Saint-Esprit pris la relève. Le notaire Jean Durand s’impliqua à la municipalité et à la commission scolaire de Saint-Esprit jusqu’en 1969. Il fût également député du comté de Montcalm et conseiller législatif.

Les luminaires de la maison sont d’origines et la fondation est composée de pierre de taille. À l’époque un fronton richement décoré était également présent sur le toit. Fait intéressant, la présence d’une saillie sur la gauche du bâtiment, qui était occupée à l’origine par une voute pour les papiers et documents du notaire.
La Banque provinciale – 64 rue Principale
Imposante demeure ayant été le bureau du docteur Joseph Lamarche, vers 1904. Le docteur Lamarche s’installa à Saint-Esprit vers 1890. En 1914, il est le seul médecin de Saint-Esprit et celui qui mit au monde la majorité des enfants de la paroisse à l’époque. Le Dr Lamarche mourut en 1940 [i].
Cette maison fut également le site de la banque provinciale. Cette banque ouvrit dans un premier temps dans une maison privée au 82 rue Montcalm. Elle connut un succès important et fut très achalandée, car on y trouvait également le bureau des véhicules automobiles. Dans les années 50, les locaux devenant trop étroits pour répondre aux besoins, elle déménagea sur la rue principale dans une maison beaucoup plus imposante et adaptée aux besoins grandissants. La banque provinciale fut gérée par madame Parmelia Latendresse jusqu’à la fermeture dans les années 60 [ii].
 Banque provinciale
Banque provinciale
[i] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 126, 187-188).
[ii] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 255-256).
Contenu et texte © Pascal Rochon
-
Le noyau villageois
Maisons Blocs
La municipalité est caractérisée par la présence d'un type d'habitation peu commun dans l'est du Canada : La « maison-bloc », dite aussi « en enfilade », qui se définit comme un ensemble architectural englobant les fonctions résidentielles et agricoles dans une juxtaposition de bâtiments. Avec ce type d'organisation, il est possible de circuler d'un bâtiment à l'autre sans avoir à affronter les intempéries. Même si plusieurs de ces bâtiments a été modifiés au cours des années, il en subsiste encore plusieurs exemples dans la municipalité.
L’origine de ce type de maison vient de loin. Au Moyen Âge, les humains et animaux partageaient le même bâtiment. Petit à petit, les hommes se sont isolés des animaux. À l’époque de la colonisation de l’Amérique, les maisons-blocs sont très présentes en Europe. Pourtant, le type Nouvelle-France (faîte continu) est très peu répandu lors de la colonisation par les Français, alors que le type Nouvelle-Angleterre (faîte brisé) est très présent au sud de la frontière et a connu un grand succès dans certaines régions précises du Québec (Estrie et Lanaudière), principalement à cause de la venue de loyalistes américains après la révolution de 1776.
Pourquoi la maison-bloc fut rejetée par les colons français, mais fut adoptée ensuite par les Québécois quelques décennies plus tard? La réponse nous vient des conditions de vie de l’époque. Pour les colons français, la maison-bloc est synonyme de classe sociale inférieure, car elle sous-entend de vivre avec les animaux. Ces derniers veulent changer de vie et de statut social en Amérique. Donc, l’absence de ce type d’habitation durant des décennies a fait oublier l’association entre maison-bloc et classe sociale inférieure. Avec l’arrivée des loyalistes, les maisons-blocs représentent seulement une nouvelle façon de faire et cela semble fonctionnel. À Saint-Esprit, la période des maisons-blocs débute vers 1840 après l’arrivée des loyalistes à Rawdon en 1837.

Une très grande concentration de maisons-blocs est située dans le rang Côte Saint-Louis. 23 fermes sur 28 sont des maisons-blocs. Dans le village, il y en a également un très grand nombre, mais les bâtiments sont de taille plus réduite. Lors de votre visite du circuit patrimonial, remarquez les longs bâtiments attachés aux maisons dans le village. Ces bâtiments, aujourd’hui garage ou atelier, étaient à l’origine pour les animaux.
Originalement, on retrouvait les pièces suivantes dans l’ordre : Salon, chambre des parents, grande cuisine, cuisine d’été, « carré de bois », dépense, remise pour la voiture et écurie, poulailler, porcherie au rez-de-chaussée. À l’étage, on y trouvait chambres et grenier. Les chambres des enfants étaient souvent situées au-dessus de la section des animaux, afin de profiter de la chaleur.
Le style des maisons–blocs varie beaucoup selon les époques de construction. On y retrouve entre-autres des maisons de type québécois, vernaculaire américain, victorien et four-square.


Contenu et texte © Pascal Rochon
-
Le pont du moulin
 Moulin de Avila Vézina
Moulin de Avila Vézina Moulin Tremblay avant démolition
Moulin Tremblay avant démolition Moteur du moulin
Moteur du moulinService d'incendie
Les incendies ont toujours été un grave problème dans les villages à l’époque. Les maisons souvent construites en bois, avec leur toit en bardeaux de cèdre étaient placées les unes très près des autres, ce qui en faisaient des combustibles faciles et rapides. Le chauffage au bois entrainait souvent des incendies majeurs ravageant le cœur des villages. Les grands incendies de Saint-Jacques en sont de tristes exemples.
Notre municipalité à la chance d’avoir été construite autour de la rivière Saint-Esprit, permettant l'accès à une source d’eau importante. Lors d’incendies, les chaînes humaines armées de seaux d’eau permettaient de limiter les dégâts, mais s’avéraient souvent insuffisantes, surtout dans le cas des maisons éloignées où les habitants ne pouvaient que regarder avec tristesse le brasier.


C’est vers 1925 que Saint-Esprit se dote d’une première pompe motorisée tirée par des chevaux. Malheureusement, celle-ci s’enraille régulièrement, notamment lors de l’incendie de la 2e église. En 1940, la municipalité acquiert un tout petit camion pompe Willys (Ancêtre de JEEP) qui fût en service pendant 35 ans.
 Jacques Beauregard et le Jeep incendie
Jacques Beauregard et le Jeep incendie
Une première petite caserne avec pompe incendie est construite près du pont du village dans les années 50. Le mot caserne est relatif, car en fait il s’agissait davantage d’une remise permettant d’entreposer de l’équipement. Elle est remplacée quelques années plus tard par une caserne plus spacieuse, sur l’actuelle rue des Loisirs près du terrain de balle. Cette caserne est équipée d’une tour à boyaux, destinée à faire sécher ceux-ci. Le bâtiment existe toujours, mais comble de l’ironie, la tour à boyaux a disparu lors d’un incendie.
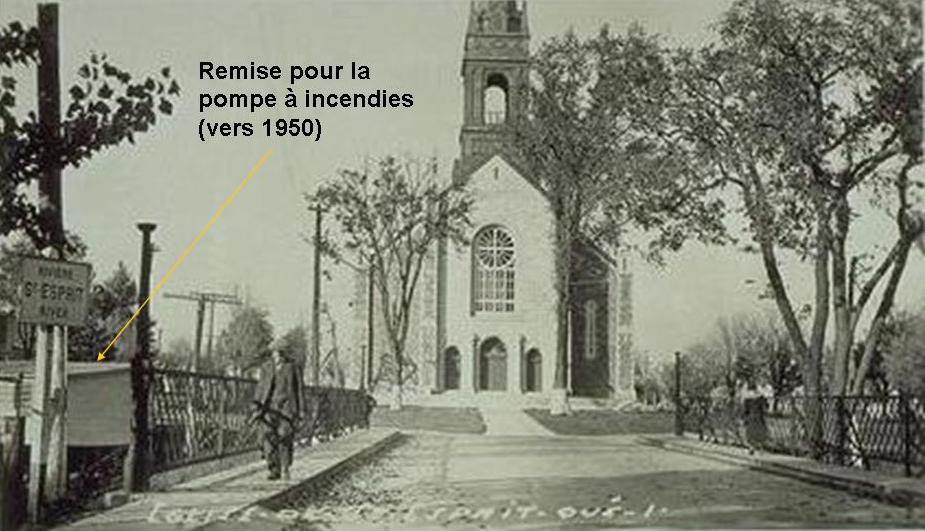 Remise pompe incendie 1950
Remise pompe incendie 1950 Première caserne (entreposage équipements)
Première caserne (entreposage équipements) 1973 Achat de nouveaux camions
1973 Achat de nouveaux camions
En 1995, le service déménage dans une nouvelle caserne située entre les rues Principale et Saint-Louis, à quelques pas de l’hôtel de ville [i].
En 2007, afin de répondre aux nouvelles normes provinciales, une entente intermunicipale est signée avec la municipalité de Saint-Alexis pour le partage des services et d’équipement d’incendie. Saint-Alexis cède ses équipements et son personnel à Saint-Esprit, qui s’engage à fournir le service en cas d’urgence. En 2010, une nouvelle fusion est réalisée avec Saint-Roch-de-l’Achigan et le service existant. En 2021, Saint-Jacques se joint également au service. L'équipe est donc dispersée dans quatre casernes (Saint-Alexis, Saint-Esprit, Saint-Roch-de-l'Achigan et Saint-Jacques) et peut compter sur près d'une dizaine de véhicules d’urgence.
 Caserne actuelle
Caserne actuelle
[i] THUOT, Jean-René. « La naissance de la communauté de Saint-Esprit, 1767-1867 ». Denis RACINE et al., dir. Saint-Esprit, 1808-2008. Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo, 2008.
Contenu et texte © Pascal Rochon
-
Le point de vue du village
 Rue Principale - orientation vers Montréal
Rue Principale - orientation vers Montréal Rue Principale en hiver
Rue Principale en hiver Restaurant du village - coin Principale et Montcalm
Restaurant du village - coin Principale et Montcalm

Montcalm coin Saint-Louis
 Montcalm coin Principale
Montcalm coin Principale Dépanneur coin Montcalm
Dépanneur coin MontcalmD’Hier à aujourd’hui – La rue Saint-Louis
La rue Saint-Louis est une petite rue locale, peu achalandée, car la circulation est plus dense sur la rue Principale. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, la rue Saint-Louis était un tronçon de la route provinciale 18 (par la suite 125) et représentait le seul accès pour se rendre à Montréal. La route 18 permettait de relier Saint-Donat et Montréal. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on ne trouvait que très peu de maisons, et aucune maison ancienne, sur la rue Principale entre la rue Montcalm et la 3e avenue? La rue principale dans ce secteur n’existait tout simplement pas. L’intersection Principale/Montcalm était en « T » et on y trouvait une jolie maison québécoise blanche. Les gens circulant vers Montréal devaient donc obligatoirement bifurquer vers la rue Saint-Louis.


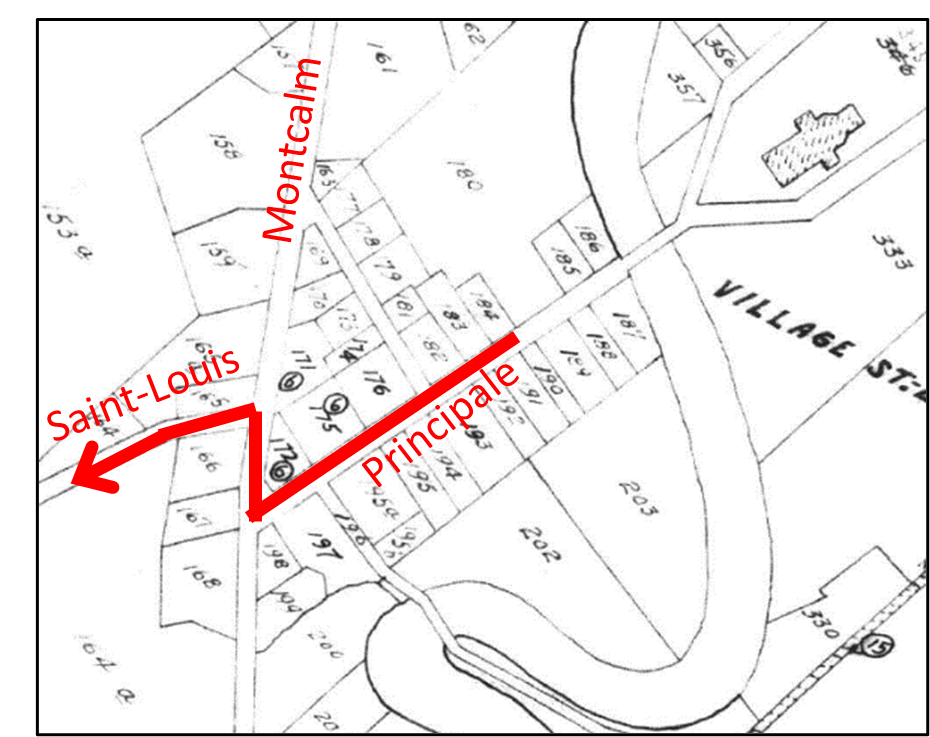
Garage Lachapelle - 45 rue Saint-Louis
Le garage de monsieur Hormidas Lachapelle ouvrit ses portes sur la rue Saint-Louis vers les années 30. En plus de faire de la mécanique générale et la vente d’essence, monsieur Lachapelle devint un concessionnaire Ford. Les voitures étaient commandées à l’automne, reçues au printemps et installées pour démonstration aux clients dans la cour attenante au garage.

Le garage devint la propriété de monsieur Roméo Lamarche et ensuite de monsieur Didier Beaudoin en 1937. Monsieur Beaudoin transforma le garage en atelier de rembourrage et d’ameublement en 1958. [i]
En 1969, ce bâtiment devint une succursale de la Banque Canadienne Nationale. Mme Jeannine B. Major, agente de banque, s’occupait de la gestion de celle-ci. La banque opéra 13 ans et ferma ses portes en 1982. Le bâtiment fut par la suite transformé en immeuble à logement dans sa forme actuelle [ii].

[i] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages 2014-2016).
[ii] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Page 255).
Contenu et texte © Pascal Rochon
-
Un village prospère et fertile
Un village prospère et fertile
103-105 RUE MONTCALM
Année 1912, style victorien
Grande maison victorienne de brique ayant abrité un comptoir de la caisse populaire. Cette maison appartient à la famille Rivest depuis ses débuts. Située sur un immense terrain, elle possède à l’arrière plusieurs bâtiments de ferme d’époque.
52-54 RUE PRINCIPALE
Année 1926, Style Victorien
Cette demeure très bien conservée possède beaucoup d’éléments architecturaux typiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À l’intérieur, les murs, plafonds, les moulures faites de plâtre et les boiseries nombreuses donnent une prestance certaine à cette résidence. Noter que la fondation de pierre de taille piquée, la galerie de bois richement décorée, son toit de tôle pincée, ainsi que les vitraux présents dans les impostes des fenêtres et des portes démontrent bien l’aisance financière des propriétaires de l’époque. Cette maison est la deuxième construite à cet endroit, la première ayant été détruite par un incendie. Cette demeure a la particularité d’avoir une sœur jumelle à quelques adresses de distance, soit au 44 rue Principale.
99 RUE MONTCALM
Année 1912, style victorien
Cette maison de brique fut construite par Achile Lamarche, prospère commerçant de bois et de grains. Le dentiste Bruno Charbonneau y installa son bureau pendant de nombreuses années (1934-1975) et le dentiste Michel Brisson prit la relève de 1978 à 2013. Cette maison a conservé ses éléments architecturaux d’origine. La galerie possède plusieurs boiseries décoratives et le détail des fenêtres de bois est très intéressant. La toiture de la tourelle, en en tôle écailles de poisson est spectaculaire. À noter l’imposte de tête de lion dans la brique.
121 RUE MONTCALM
Année 1905, style Boomtown
Cette maison Boomtown possède quelques éléments associés aux styles second empire, dont le toit de la galerie du 2e étage fait en tôle écailles de poisson. Le revêtement extérieur est fait de tôle embossée, imitant la pierre de taille. La toiture est d’origine et faite en tôle à baguette. L’ornementation de la galerie et les poteaux tournés sont d’origines. Cette maison fut celle de Lionel Rochon, menuisier, qui possédait son atelier de bois à l’arrière. Ce dernier est toujours présent et est recouvert de son bardeau de cèdre d'origine. De nombreux éléments architecturaux des maisons de Saint-Esprit proviennent de l'atelier de Lionel. Monsieur Rochon fut également policier municipal de Saint-Esprit et mandataire du bureau des licences.
59 RUE MONTCALM
Année 1908, style vernaculaire américain d’inspiration néo-Queen Ann
Cette maison possède sa toiture en tôle à la canadienne et son revêtement de bois d’origine. Le choix des couleurs et leurs proportions permettent de mettre en évidence les nombreux détails architecturaux de boiseries qui la recouvrent.
68 RUE MONTCALM
Construction 1900, style victorienne d’inspiration Queen-Ann
Cette imposante demeure Victorienne fut construite par Avila Lachapelle entre 1896 et 1900. Boulanger de profession, M. Lachapelle fut celui qui construisit et opéra la boulangerie de Saint-Esprit (four à pain en pierre) durant de longues années au 117 Montcalm, ce qui explique la présence des vestiges d’un tel four dans le sous-sol de cette maison. Avec ses grandes pièces et ses plafonds de plus de 10 pieds, l’intérieur a conservé ses caractéristiques d’origines telles que les murs de plâtres, les vasistas et les nombreuses moulures et portes ouvragées qui ornent les pièces de la maison. À l’extérieur, le choix des couleurs permet de mettre en valeur la mouluration détaillée des boiseries, corbeaux et caissons de la corniche. On remarque aussi les nombreux détails architecturaux des chambranles de fenêtre. Les éléments de l’immense galerie tels que les colonnes doriques sont d’origine. Fait intéressant : cette maison était la seule à posséder une toiture complète d’ardoise avec motifs, ce qui démontre bien l’aisance financière de son propriétaire à l’époque.
Contenu et texte © Pascal Rochon
-
Maison Lachapelle Perreault

Maison victorienne d’inspiration néo Queen-Ann
68 rue Montcalm


Description et style de la maison
Cette demeure bourgeoise victorienne en brique d’inspiration Queen-Ann est située à Saint-Esprit dans la région de Lanaudière. Construite sur la rue Montcalm, en plein cœur du village, elle fait partie d’un ensemble de maisons de briques construite dans les mêmes années. Contrairement aux villages avoisinants organisés de façon rectiligne, Saint-Esprit s’est consolidé sous la forme d’un petit bourg Français. Combiné à une population aisée à l’époque, cette configuration spatiale fait en sorte que Saint-Esprit possède un très grand nombre de maisons bourgeoises et cossues dans un espace restreint.
Cette maison, assise sur une solide fondation de moellon, possède de nombreuses caractéristiques d’époque propre à son style victorien. Il y a évidemment sa « tourelle », ainsi que la grande galerie qui ceinture la maison. La mouluration et autres éléments architecturaux décoratifs sont omni présents. Par exemple, les corniches possèdent de nombreux modillons complexe et caissons. Les colonnes doriques sont d’origine et les encadrements de fenêtres à guillotine en bois, particulièrement les chambranles de fenêtre, sont ornés d’impressionnants détails ouvragés. Les portes de bois massif sont également ornées et sculptées de nombreux détails. Le toit des galeries est fait de tôle à baguette d’origine. Le toit de la maison, quant à lui, était à l’origine entièrement fait d’ardoise avec motif, ce qui démontre bien l’aisance de son propriétaire d’époque. Malheureusement, l’ardoise fût retirée il y a déjà quelques années.
Vue de l’intérieur, les détails architecturaux ne manquent pas. Les pièces sont très grandes et les plafonds de plus de 10 pieds sont entièrement faits de moulures et donnent un effet de grandeur et de richesse incroyable. Les murs, en plâtre d’origine, sont ornés de plinthe et moulures de plus de 14 pouces, de cimaises et de corniches. Chacune des portes intérieures est en bois massif et richement ornée de mouluration et rosette. Les vasistas d’origine sont toujours présents et fonctionnels et permettent la circulation optimale de la chaleur.
La maison est située sur une partie du lot originaire numéro 159 dans le comté de Montcalm. Entre 1890 et 1896, le terrain de la maison appartenait à Cyprien Gourd (Marie-Mathilde Chapu), un marchand et bourgeois de la municipalité. Le 10 août 1896, monsieur Avila Jeannot, dit Lachapelle, achète le terrain pour 166,67$, afin d’y construire une somptueuse maison victorienne qu’il conservera durant quatorze ans. Anecdote ; le contrat de ventre mentionne que la prise de possession est immédiate, mais que le vendeur conserve le droit de récolter les légumes qui y sont plantés.
Boulanger de profession, Avila construisit et opéra successivement une boulangerie et une biscuiterie, plus loin sur la rue Montcalm. Cette passion explique la présence d’une fondation de four à pain dans le sous-sol de la cuisine d’été de la maison. La date exacte de la construction de la maison n’est malheureusement pas connue, mais elle aurait été construite vers 1900. Elle fut vendue pour 1 700$ à Arcade Roch (Alexina Desroches), cultivateur et bourgeois, le 4 octobre 1909. La maison fut léguée et/ou vendue à divers membres de la famille Roch-Desroches durant plus de soixante-quatre ans. En janvier 1973, Ulric Payette, dit St-Amour (Anne-Marie Allard), devinrent les nouveaux propriétaires et conservèrent la maison douze ans. De 1985 à 2000, quatre propriétaires se sont succédé. Le 13 octobre 2000, messieurs Jacques Dansereau et Rénald Boutin se portèrent acquéreur et en firent leur maison de campagne.
Finalement, le 9 mars 2012, Pascal Rochon et Nathalie Perreault en prennent possession et débutent sa restauration. L’objectif lors des travaux était de respecter la période de référence, soit les années 1900. Compte tenu que plusieurs éléments architecturaux étaient toujours présents, il suffisait de poursuivre dans la même veine, tout en permettant d’intégrer les commodités actuelles.
« Lors de la recherche des titres de propriétés, nous avons eu l’immense surprise d’apprendre que nous avions un lien particulier avec notre maison. Tout d'abord, nous avons découvert que Pascal a des ancêtres communs avec celui qui a fait bâtir la maison, Avila Lachapelle. Ce dernier est le cousin germain au 3e degré de Pascal. La famille de Pascal étant originaire de Saint-Esprit, c'était un peu normal. Cependant, nous ignorions que les ancêtres de Nathalie provenaient aussi de Saint-Esprit et faisaient partie des premiers bâtisseurs de la paroisse. Nous avons aussi appris, que Parmelia Perreault, la femme d’Avila Lachapelle, se trouve à être sa cousine germaine au 3e degré. Plus surprenant encore, le 9 mars 1896, c’est Toussaint Perreault, arrière-arrière-arrière-grand-père de Nathalie, qui a octroyé un prêt de 500,00 $ à Avila Lachapelle pour la construction de la maison. » - Pascal Rochon
Architecture et paysagement
La beauté de cette maison réside dans la quantité et la qualité des éléments architecturaux. L’objectif était de conserver l’ensemble des éléments d’origine présents. Ces derniers furent décapés au besoin et repeint. Pour les éléments détériorés, les propriétaires ont tenté le plus fidèlement possible de les réparer ou les remplacer par des éléments identiques. En ce qui concerne les éléments introuvables ou modifiés, les travaux visaient à tenter de les remettre comme ils devaient l’être à l’époque. En effectuant des recherches, en observant des maisons semblables à proximité et en se basant sur les éléments encore en place sur la maison, les propriétaires ont tenté de reproduire les éléments architecturaux qui auraient possiblement pu se trouver sur cette maison.
Lors de l’achat, les boiseries et fenêtre étaient peintes en blanc. En effectuant un curetage minutieux, les couleurs d’origine ont été révélées. Par exemple, le jaune ocre et le vert se retrouvaient sur la galerie avant. Les recherches effectuées dans la littérature ont également permis d’identifier les couleurs utilisées vers 1900 pour les maisons victoriennes. En combinant ces informations, le propriétaire a été en mesures d’établir une charte de couleurs appliquées aux différents éléments architecturaux.
En ce qui concerne l’extérieur de la maison, les travaux effectués en respectant le style de la maison et du village. Tout d’abord, les couleurs choisies sont des couleurs d’origine respectant les chartes de couleurs des maisons victoriennes de l’époque. Les maisons avoisinantes étant également en brique rouge, cela crée une belle intégration. Les bâtiments accessoires ont été construits avec des formes et des matériaux nobles d’époque. Ils sont peints d’une couleur s’agençant avec la maison. Les plantes et fleurs sont de variétés champêtres. L’aménagement, composé de pierres et de fleurs, autour de la piscine permet d’intégrer cet élément moderne de façon fluide.
Impacts de la restauration dans l'environnement
La restauration et la mise en valeur d’une maison patrimoniale, surtout dans un secteur relativement dense et au cœur du noyau villageois, à inévitablement un effet sur son environnement. Tout d’abord, tout au long des travaux, les résidents ont été à même de remarquer l’amélioration et voir la maison évoluer. Combiné à la mise en place d’un PIIA, les travaux de restauration ont pavé la voie à une prise de conscience des propriétaires du village de la richesse patrimoniale de leur maison. Il suffit parfois de quelques exemples concrets de restauration pour inciter les gens à effectuer des travaux. Ainsi, de plus en plus de maisons sont mises en valeur.



Contenu et texte © Pascal Rochon

